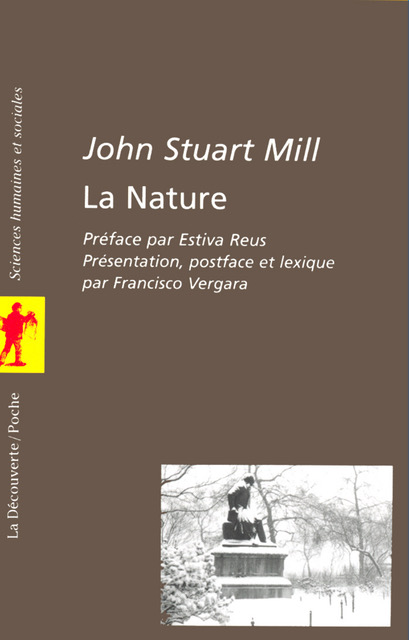La Nature est un essai de philosophie morale (Footnote: Il fut publié à titre posthume par la belle-fille de John Suart Mill, Helen Taylor, qui le fit paraître en 1874 dans un volume intitulé Three Essays on Religion. La Nature est chronologiquement le premier de ces essais. Il fut probablement rédigé entre 1854 et 1858.). John Stuart Mill se propose d’examiner « la validité des doctrines qui font de la nature un critère du juste et de l’injuste, du bien et du mal, ou qui d’une manière ou à un degré quelconque approuvent ou jugent méritoires les actions qui suivent, imitent ou obéissent à la nature » (p. 55). Le sujet lui paraît important parce que l’idée de nature est omniprésente dans les discours à vocation normative. Ce qui est naturel est bien, disent les hommes depuis des siècles. En pratique, ajoute l’auteur, leur attitude est plus ambiguë : tantôt ils dénoncent avec indignation ce qu’ils jugent contre nature, tantôt ils célèbrent les conquêtes qui ont permis à l’humanité d’échapper aux rigueurs de sa condition primitive, dénigrant par là même l’ordre naturel spontané. Personne ne souhaite vraiment que nous imitions la nature en tout point, mais « les hommes ne renoncent pas volontiers à l’idée qu’une partie de la nature au moins a été conçue comme un exemple ou un modèle » (p. 79). Ce constat reste si vrai à notre époque que le lecteur ne saurait rester indifférent à la question posée par Mill, ni à la réponse qu’il y apporte : « La conformité à la nature n’a absolument rien à voir avec le bien et le mal » (p. 95). Il est possible que ce verdict sans appel heurte ses convictions personnelles. Peut-être se laissera-t-il néanmoins convaincre par la rigueur de l’argumentation développée par l’auteur. En tout cas, il ne lui échappera pas que le débat a des enjeux très réels. Il touche un sentiment profond qui se manifeste dans les détails de la vie quotidienne, mais qui affecte aussi les idées avancées sur des questions sensibles et controversées (Footnote: Dans son livre Dans le jardin de la nature (Gallimard, 1985), Keith Thomas retrace l’histoire (en Angleterre) des discours, des pratiques et des sensibilités en ce domaine.).
La révérence pour l'ordre naturel
De nos jours en effet, le naturel reste fortement associé à des jugements de valeur. La publicité en fournit une illustration caricaturale. Elle utilise le mot nature pour désigner ou évoquer n’importe quelle notion à connotation positive : campagne, santé, tradition, éternité, force, authenticité, sagesse, simplicité, paix, splendeur, abondance...
L’avantage donné au naturel côtoie avec plus ou moins de bonheur l’idéologie de la victoire sur la nature. Les avancées des sciences et techniques sont habituellement saluées comme des progrès. Cependant, le fait d’en accepter les résultats avec gratitude n’empêche pas de ressasser des propos alarmistes sur les risques encourus en jouant aux « apprentis-sorciers ». Le dosage des deux attitudes obéit à une logique mystérieuse, que Mill soupçonnait dénuée de fondement rationnel :
Aucune doctrine reconnue n’a jamais établi quelles étaient les portions particulières de l’ordre naturel qu’il fallait supposer destinées à notre direction morale ; par conséquent, chacun a décidé selon ses prédilections ou sa convenance du moment […]. (p. 79)
Aujourd’hui, la génétique et les biotechnologies sont victimes au premier chef du réflexe « pro-nature », notamment lorsqu’elles touchent à la reproduction humaine. D’autres innovations dans les pratiques médicales sont quant à elles rangées sans états d’âme du côté du progrès. Que cette distinction provienne pour partie d’une réflexion sur les conséquences possibles des unes et des autres ne fait pas de doute. Mais cela suffit-il à expliquer pourquoi aider un couple à mettre au monde un enfant par fécondation in vitro soulève, selon la formule consacrée, de « graves problèmes éthiques », alors que remédier, avant la conception, à certaines causes de stérilité n’en pose pas ? Tout se passe comme si on avait décrété que certains domaines relevaient du sacré : la nature a prévu une procédure précise de reproduction et on s’exposerait à des sanctions terribles en ne s’y pliant pas.
Des réactions du même ordre se manifestent épisodiquement dans les domaines les plus divers : soudain, la crainte inspirée par quelque menace nouvelle ressuscite l’idée que la nature commande et punit. Ainsi, l’inquiétude suscitée par la transmission à l’homme de l’encéphalopathie spongiforme bovine a fait dire que le malheur venait de ce qu’on s’était permis de nourrir des bêtes naturellement herbivores avec des farines animales (Footnote: En revanche, la pratique routinière de l’insémination artificielle sur les mêmes vaches n’a ni scandalisé l’opinion publique, ni agité les comités d’éthique.).
La pénétration dans le grand public des thèmes de l’écologie politique a renforcé ce penchant. Là encore, il ne s’agit pas de nier que l’incompatibilité entre certaines pratiques et des objectifs jugés souhaitables justifie l’attention portée à ces questions. Mais au-delà, on assiste à la résurgence d’une structure très ancienne de pensée religieuse, apparemment laïcisée par le remplacement du mot Dieu par celui de nature. On la devine par exemple derrière les discours qui élèvent le respect des équilibres naturels au rang de valeur en soi. Au sens premier, l’équilibre est un terme purement descriptif. Il désigne un état d’immobilité ou de permanence : les relations qu’entretiennent les éléments d’un écosystème sont telles qu’il conserve sa structure, les êtres qui le composent étant soit invariants, soit renouvelés à l’identique (Footnote: Malgré son succès dans la pensée environnementale, la notion d’équilibre naturel ne correspond probablement à aucune réalité. Cf. Daniel Botkin, Discordant Harmonies, A New Ecology for the Twenty-First Century, Oxford University Press, 1990.). Dans le langage courant cependant, le mot équilibre désigne plus que cet état particulier (de repos par opposition au mouvement), pour revêtir le sens d’un état idéal. L’équilibre des écosystèmes se mue en « ordre de la nature » ou en « harmonie naturelle ». La notion d’ordre évoque un système où chaque être ou catégorie d’êtres se trouve à sa juste place. Celle d’harmonie fait songer à un état d’union ou d’entente, où chaque partie s’accorde au mieux avec les autres pour contribuer à la beauté de l’ensemble. Ces mots font naître l’image d’une nature ordonnatrice du monde pour le bien de ses créatures, tout en faisant sentir le danger qu’il y aurait à en déranger la perfection.
Mill pour sa part ne voit dans la nature ni harmonie spontanée, ni modèle à suivre, ni source de châtiments utiles ou mérités : « La simple vérité est que la nature accomplit chaque jour presque tous les actes pour lesquels les hommes sont emprisonnés ou pendus lorsqu’ils les commettent envers leurs congénères » (p. 68). Il détaille ses méfaits envers les humains ou les autres animaux. Il poursuit par une attaque en règle des tentatives faites pour justifier les malheurs qu’elle cause par les bienfaits censés en résulter, tentatives qu’il impute à l’effort désespéré de certains théologiens pour soutenir que la création est toujours bonne puisqu’elle est l’œuvre de Dieu (Footnote: Ce qui l’amène à conclure que si Dieu existe et qu’il est bon, alors il n’est pas tout-puissant. Cette idée reparaîtra dans ses deux essais ultérieurs sur la religion : Utilité de la religion et Le Théisme.).
Nature et éthique : le saut de « ce qui est » à « ce qui doit être »
Tournons-nous à présent vers une autre manifestation du sentiment diffus selon lequel les normes éthiques sont inscrites dans la nature. Elle consiste à convertir en frontières morales certaines partitions opérées en son sein, selon un procédé très particulier.
Pour saisir la réalité qui nous entoure, nous la découpons en ensembles homogènes au regard d’un ou plusieurs critères. Les catégories ainsi distinguées ne sont a priori qu’une nomenclature descriptive adaptée pour certains usages, et inadaptée pour d’autres. (Les martiens et les grenouilles sont rangés ensemble parmi les objets verts, mais ils sont dans des tiroirs différents si l’on cherche à séparer les êtres terrestres des extraterrestres). Il arrive pourtant que certaines de ces classes accèdent à une dignité particulière. Elles s’autonomisent pour devenir une réalité première, les êtres qui les composent n’étant plus perçus que comme des supports de cette réalité, ou comme des manifestations d’une essence unique. Le même processus conduit généralement à associer à cette essence une finalité. Les êtres composant la classe sont faits pour quelque chose ou destinés à se comporter d’une certaine manière. Ce n’est qu’en accomplissant ce pour quoi ils sont faits qu’ils réalisent leur vraie nature. De ce que les êtres appartenant à telle catégorie obéissent à des lois de la nature spécifiques, on croit pouvoir déduire directement les règles relatives à la façon dont ils doivent être traités. De même, on pense parfois que les propriétés des choses indiquent immédiatement la façon moralement juste d’en user. Le glissement est aisé car, indéniablement, les caractéristiques des êtres ou des choses ont un rapport avec les préceptes les concernant. Mais est-il possible de passer, sans la médiation d’un principe tiers, d’une proposition purement descriptive (par exemple : « Privé de nourriture, un être vivant dépérit et meurt ») à un précepte moral (« Nous avons le devoir de secourir les affamés ») ? Mill à la suite de Hume (Footnote: David Hume, Traité de la nature humaine (1739, 1740), Livre III, première partie, section 1, GF-Flammarion, Paris, 1993, p. 65.) nous invite à refuser le glissement entre is et ought, ou la confusion entre ce qui est et ce qui doit être.
Pourtant, les exemples ne manquent pas où le constat d’une faculté ou d’une propriété se transforme en l’affirmation tantôt d’un droit, tantôt d’une finalité ou d’un devoir être. Là aussi avec toute l’apparence de l’arbitraire dans la sélection des domaines où s’accomplit ce passage et de ceux où il n’est jamais évoqué. Ainsi, le fait que les femmes puissent enfanter a souvent conduit à l’idée qu’elles devaient enfanter ou que leur véritable nature ne s’accomplissait que dans la maternité. Le fait que les organes sexuels mâles et femelles permettent la procréation a pu être interprété comme un commandement de la nature (ou de Dieu) exigeant qu’ils ne servent qu’à cela (Footnote: On lit par exemple dans le Catéchisme de l’Église catholique à propos des relations homosexuelles : « S’appuyant sur la Sainte Écriture qui les présente comme des dépravations graves, la Tradition a toujours déclaré que "les actes d’homosexualité sont intrinsèquement désordonnés". Ils sont contraires à la loi naturelle. Ils ferment l’acte sexuel au don de la vie. Ils ne procèdent pas d’une complémentarité sexuelle et affective véritable. Ils ne sauraient recevoir d’approbation en aucun cas. » (Mame/Plon, Paris, 1992, p. 480.)). En revanche, le fait que la bouche soit un point d’entrée pour l’ingestion des aliments a rarement conduit les moralistes à désapprouver ceux qui s’en servent pour souffler dans une clarinette.
Dans son essai sur La Sujétion des femmes (1861) J. S. Mill observe que très souvent ce qui est perçu comme naturel n’est en réalité que ce qui est habituel ou admis dans une société donnée, en particulier chez ceux qui s’y trouvent en position dominante :
Certains objecteront qu’on ne saurait honnêtement comparer le gouvernement du sexe masculin aux formes de pouvoir injuste que j’ai évoquées pour l’illustrer, puisque les secondes sont arbitraires [...] alors que le premier est au contraire naturel. Mais a-t-il jamais existé une domination quelconque qui ne soit apparue naturelle à ceux qui l’exerçaient ? Il fut un temps où la division de l’humanité en deux classes, l’une petite composée de maîtres et l’autre nombreuse composée d’esclaves, semblait naturelle, même aux esprits les plus cultivés [...]. [...] Aristote soutenait cette opinion sans doute ni hésitation, et l’appuyait sur des prémisses identiques à celles qui fondent habituellement la même affirmation concernant la domination des hommes sur les femmes, à savoir qu’il y a différentes natures parmi le genre humain, des natures libres et des natures serviles, que les Grecs étaient d’une nature libre et les races barbares des Thraces et des Asiatiques d’une nature servile. Mais qu’ai-je besoin de remonter à Aristote ? Les propriétaires d’esclaves du sud des États-Unis ne soutiennent-ils pas la même doctrine [...] ? Ne prennent-ils pas le ciel et la terre à témoin que la domination de l’homme blanc sur le noir est naturelle, que la race noire est par nature incapable de liberté et destinée à l’esclavage [...] ? De même, les théoriciens de la monarchie absolue ont toujours affirmé qu’elle était la seule forme naturelle de gouvernement, issue du gouvernement patriarcal, qui était la forme primitive et spontanée de la société, façonnée sur le modèle du gouvernement paternel, antérieur à la société elle-même et qui est, selon eux, l’autorité la plus naturelle de toutes. [...] La moindre connaissance de la vie des hommes au Moyen Âge laisse voir à quel point extrême la domination de la noblesse féodale sur les gens de basse condition paraissait naturelle aux nobles eux-mêmes [...]. Elle ne le semblait guère moins à la classe tenue en sujétion [...]. Tant il est vrai qu’en général on qualifie de contraire à la nature ce qui est simplement inhabituel, et que tout ce qui est habituel paraît naturel (Footnote: John Stuart Mill, The Subjection of Women, dans On Liberty and Others Essays, World’s Classics, Oxford University Press, Oxford, 1991, p. 482-483.).
Par-delà ces considérations d’ordre psychologique ou sociologique, Mill fait valoir l’absurdité qu’il y a à justifier les contraintes et interdits imposés aux femmes par le souci de les voir se conformer à leur nature :
Une chose dont on peut être sûr est qu’on n’amènera jamais les femmes à faire ce qui est contraire à leur nature simplement en laissant leur nature jouer librement. Le souci du genre humain d’intervenir pour le compte de la nature, de peur que la nature ne réussisse pas à atteindre son but est une sollicitude totalement inutile. Il est parfaitement superflu d’interdire aux femmes de faire ce qu’elles sont incapables de faire par nature (Footnote: Ibid, p. 499.).
Il importe de souligner que l’auteur critique ici un mode de raisonnement. Car, dans notre société, peu de gens défendent ouvertement l’esclavage ou le maintien d’un statut inférieur pour les femmes. Cependant, le fait que l’opinion aujourd’hui dominante rejoigne le point de vue de Mill sur certaines conclusions pratiques n’implique pas qu’elle ait renoncé à chercher sa justification dans les intentions de la nature, ni qu’elle conteste la pertinence morale des limites naturelles. Nous en prendrons quelques exemples.
Nature et droits de l’homme
Le premier nous amène à souligner qu’on ne saurait accuser l’optique « naturaliste » d’avoir systématiquement soutenu le traitement inégal de diverses catégories d’humains. Certains s’en sont servis dans ce but, d’autres dans le but inverse. À notre époque, bien des gens considèrent la défense des droits de l’homme comme une très noble cause, parce qu’ils perçoivent ces droits comme le meilleur rempart contre l’oppression ou les inégalités arbitraires. Or, les inspirateurs de la Déclaration des droits de l’homme de 1789 (Footnote: Tout comme les auteurs des déclarations américaines: la Déclaration d’indépendance de 1776, les Déclarations des droits (Bills of Rights) de chacun des États fédérés, les dix premiers amendements de la constitution fédérale de 1787.) s’appuyaient précisément sur la doctrine éthique que Mill récuse (la philosophie du droit naturel) : ils pensaient que les droits fondamentaux (droit à la vie, à la propriété, à la liberté) se découvraient par l’observation de la nature humaine. Ainsi, la merveilleuse adaptation de notre organisme à l’accomplissement des fonctions vitales prouverait que l’intention de la nature est que nous vivions, tout en indiquant qu’il est de notre devoir de respecter ses desseins. Ou encore, on pourrait déduire le droit à la vie de ce que l’homme est fait par nature pour vivre en société et que la sécurité des personnes est une condition nécessaire à l’existence d’une société ordonnée. Suivre Mill dans sa critique de cette forme de pensée, c’est dépouiller les droits de l’homme de ce qui les rendait évidents et sacrés aux yeux de leurs promoteurs. S’ils doivent être défendus, c’est en vertu d’un autre principe que celui de leur conformité à la nature (Footnote: On trouvera dans l’ouvrage de Francisco Vergara Introduction aux fondements philosophiques du libéralisme (La Découverte,Paris, 2002) un exposé des fondements du droit naturel et de ceux de la philosophie concurrente, l’utilitarisme, à laquelle se rattache Mill. L’auteur y montre notamment que la défense de la liberté repose sur des arguments sensiblement différents chez les deux écoles. La position de Mill sur ce thème est développée dans son essai On Liberty, paru en 1859.).
Nature et discriminations intra-humaines (racisme, sexisme...)
En second lieu, on observera qu’il n’est pas certain que le fait de condamner les discriminations évoquées par Mill dans le passage précédemment cité implique un franc rejet de l’idée selon laquelle la nature dicte ce qui est bien. Le plus souvent en effet, la stratégie employée ne consiste pas à nier la pertinence du procédé consistant à déduire le statut éthique de tel groupe de ses caractères naturels, mais à réfuter le diagnostic porté par le passé sur ces caractères : on s’est trompé sur la nature de telle catégorie, et la rectification de cette erreur conduit à réviser la place qui lui revient. Pour combattre ceux qui érigent l’appartenance à une classe en signe d’une finalité, on ne se contente pas de contester que les différences naturelles appellent des hiérarchies sociales. On cherche plutôt à faire disparaître la classe concernée des esprits en rendant ses contours aussi flous que possible. Cette tactique est particulièrement évidente concernant le racisme lorsqu’elle se résume dans la formule « les races n’existent pas, il n’y a qu’une seule race humaine ». Concernant le sexisme, l’affirmation équivalente « les sexes n’existent pas » est trop abrupte pour s’afficher sous cette forme, mais la proposition selon laquelle « nous avons tous du féminin et du masculin en nous » en est un substitut fréquemment employé. Ces formes d’argumentation ont en commun de pouvoir être menées sans remettre en cause les deux caractéristiques de l’approche « naturaliste » indiquées plus haut : la transformation des individus concrets composant une classe en êtres génériques porteurs de l’essence de leur catégorie (Footnote: Cette transformation étant rarement explicite ou consciente, il convient de souligner que ceux qui croient pouvoir défendre des préceptes égalitaires sur la base des affirmations précédemment évoquées sont dans la nécessité logique d’y faire appel. Prenons l’exemple du racisme. Les défenseurs de l’esclavage des Noirs s’appuyaient sur les caractéristiques supposées de cette race d’hommes (faible intelligence, caractère enfantin, incapacité à concevoir des projets complexes et à œuvrer avec constance pour les atteindre...). Le fait qu’il n’y ait en réalité aucune différence en ces domaines entre les Noirs et les Blancs permet certainement de contrer leur argumentation en restant sur le même terrain. Si l’on admet que les caractéristiques imputées à la population noire justifieraient sa mise en esclavage, alors le fait de savoir que ces caractéristiques ne sont pas conformes à la réalité doit amener à refuser l’esclavage des Noirs en tant que Noirs. Mais cela ne suffit pas pour juger moralement inacceptable toute forme d’esclavage. En effet, même si le Noir et le Blanc moyens présentent les mêmes caractères, il n’en reste pas moins vrai que, parmi les humains blancs ou noirs, certains sont nettement moins intelligents, moins entreprenants, moins capable de prévision à long terme, etc. que les autres. Il n’y aurait donc aucune objection à ce que les humains (blancs ou noirs) présentant des compétences inférieures à la moyenne deviennent la propriété de ceux dotés de qualités supérieures. Ce n’est certes pas ce qu’entendent soutenir les pourfendeurs de l’esclavage, mais quel moyen ont-ils d’échapper à cette conclusion ? Une issue possible, mais difficilement défendable, consiste à maintenir que l’égalité ou l’inégalité naturelles justifient l’égalité ou l’inégalité de statut, mais que les individus ne doivent pas être considérés en eux-mêmes, mais saisis comme des représentants de leur catégorie. Le Noir ou le Blanc mentalement attardé ne doit pas être exploité comme esclave parce qu’il est dépositaire des qualités du Noir ou du Blanc en général, c’est à dire représentatif de l’homme moyen ou idéal, bien qu’il ne lui ressemble pas. (La construction semble fragile. Car, si au lieu de partir des catégories « Noirs » « Blancs » ou « humains », on avait pris comme point de départ les classes des individus ayant un QI inférieur ou supérieur à 100, ou qu’on les avait distribués selon leurs capacités d’anticipation ou de persévérance, il n’aurait pas suffi de considérer chacun comme le représentant de son groupe pour occulter la spécificité des moins bien dotés.) Une issue moins tortueuse existe, mais elle exige une rupture franche avec la tentative de déduire l’égalité de droit de l’égalité de fait. On trouvera une discussion de ces thèmes dans le chapitre 2 de Practical Ethics de Peter Singer (Cambridge University Press, Cambridge, 1993) ainsi qu’un plaidoyer en faveur de la seconde solution : pour Singer, l’égalité est une prescription sur la façon dont les individus doivent être traités qui ne doit rien à une affirmation de fait relative à l’égalité de leurs compétences. C’est le principe éthique qui exige une égale prise en considération des intérêts, quelles que soient les caractéristiques des êtres porteurs de ces intérêts. Une traduction française de Practical Ethics a été publiée sous le titre Questions d’éthique pratique (Bayard Éditions, Paris, 1997).), et l’hypothèse selon laquelle les traits naturels d’une classe suffisent à justifier le statut éthique de ses membres.
Nature et spécisme (Footnote: Le terme spécisme a été forgé sur le modèle des mots racisme ou sexisme. Il désigne la discrimination arbitraire à l’encontre de ceux qui n’appartiennent pas à notre espèce.)
On mentionnera pour finir un domaine dans lequel l’opinion majoritaire ne peut être expliquée autrement que par l’adhésion à ces deux postulats, bien que ceux qui la partagent en aient rarement conscience. Il s’agit de la définition des êtres envers qui nous avons des devoirs (les « patients moraux »). À qui doit-on appliquer des préceptes tels que « ne pas tuer », « ne pas faire souffrir », « ne pas traiter autrui comme un simple moyen pour parvenir à nos fins » ? Généralement, la réponse est : aux êtres humains, alors qu’elle aurait pu être : à tous ceux pouvant pâtir de ces comportements. Il y a peu de sujets où une limite naturelle (Footnote: C’est-à-dire un découpage opéré au sein de la réalité à des fins de classification.), en l’occurrence celle d’une espèce, est utilisée avec aussi peu de précautions comme frontière morale. Pour ceux que l’on a ce faisant exclus, on admet non seulement que leur bien se confond avec ce que la nature a prévu pour eux, mais on l’assimile au besoin avec ce à quoi ils nous servent : les chats sont faits pour attraper les souris, les moutons pour être tondus et les poulets pour être rôtis. Y-a-t-il donc un ou des caractères naturels qui justifient de façon évidente que l’ensemble des patients moraux se confonde avec l’espèce humaine (Footnote: Un inventaire et une analyse critique des théories plaidant en faveur d’une réponse positive sont proposés dans Animal, mon prochain de Florence Burgat (Odile Jacob, Paris, 1997).) ? Le simple fait de poser la question est souvent jugé sacrilège. Pourtant, si l’on considère les membres concrets de l’espèce, on a le plus grand mal à trouver un caractère qui soit à la fois exclusivement humain et présent chez tous les humains. Les traits distinctifs généralement invoqués n’appartiennent pas à tous les hommes. Ils caractérisent l’humain-type. De surcroît, le saut périlleux consistant à convertir les individus concrets en autant d’exemplaires de l’humain générique, ne suffit pas à rendre intelligible la restriction à l’humanité de la sphère de prise en considération morale, car surgit alors une seconde difficulté : les traits mis en avant ne semblent pas avoir de rapport avec ce qu’ils sont sensés justifier (Footnote: On trouvera une discussion plus extensive de ces thèmes dans divers articles parus dans Les Cahiers antispécistes ainsi que dans les contributions d’Yves Bonnardel, David Olivier et James Rachels à deux ouvrages collectifs parus aux éditions tahin party : Espèces et éthique (Lyon, 2001) et Luc Ferry ou le rétablissement de l’ordre (Lyon, 2002).).
Jeremy Bentham formulait en ces termes les objections que soulève une telle attitude :
Les français ont déjà découvert que la noirceur de la peau n’est en rien une raison pour qu’un être humain soit abandonné sans recours au caprice d’un bourreau. On reconnaîtra peut être un jour que le nombre de pattes, la pilosité de la peau, ou la façon dont se termine le sacrum sont des raisons tout aussi insuffisantes pour abandonner un être sensible au même sort. Et quel autre critère devrait tracer la ligne infranchissable ? Est-ce la faculté de raisonner, ou peut-être celle de discourir ? Mais un cheval ou un chien adulte sont des animaux incomparablement plus rationnels et aussi plus causants qu’un enfant d’un jour, d’une semaine, ou même d’un mois. Mais s’ils ne l’étaient pas, qu’est-ce que cela changerait ? La question n’est pas : peuvent-il raisonner ? ni : peuvent-ils parler ? mais : peuvent-ils souffrir (Footnote: Jeremy Bentham, An Introduction to the Principles of Morals and Legislation, chapitre 17, Basil Blackwell, Oxford, 1948, p. 412. La première édition de ce livre date de 1789.) ?
Chez Bentham, ce passage est une simple note, précédée de considérations qui en réduisent notablement la portée. En revanche, ces sujets ont été amplement développés dans la philosophie éthique contemporaine (Footnote: Le mouvement a été initié par Peter Singer dans le courant utilitariste avec la publication en 1975 d’Animal Liberation (dont une traduction française est parue chez Grasset en 1993 sous le titre La Libération animale). Dans la mouvance anti-utilitariste des conclusions pratiques voisines ont été atteintes par Thomas Regan dans The Case for Animal Rights (Éditions University of California Press, Berkeley, 1983).).
La position défendue par Mill dans La Nature
L’essai de Mill n’apporte pas tous les éléments nécessaires pour se prononcer sur les quelques thèmes évoqués ici, mais il contient une mise en garde contre les raisonnements fallacieux qu’on pourrait être tenté d’y appliquer. L’auteur ne cherche ni à délimiter les patients moraux, ni à définir le critère ultime du bien. Son objectif est plus restreint : montrer que la règle « obéir à la nature » ne saurait constituer le fondement de la morale. La raison qu’il en donne est à la fois simple et puissante : ce précepte doit être rejeté parce qu’il est vide de sens. En effet, le mot nature désigne « soit le système entier des choses avec l’ensemble de leurs propriétés, soit les choses telles qu’elles seraient en l’absence d’intervention humaine » (p. 97). Si on retient le premier sens, il est vain de préconiser comme règle de conduite le respect des lois de la nature, puisque nul ne saurait s’y soustraire. Si on retient le second, toute action humaine constitue une infraction aux lois naturelles. « Se conformer à la nature » est donc soit un truisme, soit une impossibilité.
Pour l’essentiel, Mill s’en tient dans ce court essai à ce résultat purement négatif, laissant le lecteur orphelin de ce par quoi il justifiait peut-être ses convictions morales, sans rien lui proposer à la place. Cependant, les jugements de valeur portés par l’auteur s’appuient implicitement sur un principe éthique précis, qu’il a amplement développé par ailleurs. Mill adhère à l’éthique utilitariste qui « admet l’utilité, ou le principe du plus grand bonheur, comme fondement de la morale » et qui soutient que « les actions sont bonnes dans la mesure où elles tendent à promouvoir le bonheur, et mauvaises dans la mesure où elles tendent à produire le contraire du bonheur », sachant que « le bonheur qui constitue la norme utilitariste de bonne conduite n’est pas celui de l’agent lui-même, mais celui de tous ceux qui se trouvent concernés » (Footnote: John Stuart Mill, Utilitarianism, dans On Liberty and Other Essays, op. cit., p. 137 et p. 148. Une traduction française de Utilitarianism a été publiée : L’Utilitarisme, PUF, coll. Quadrige, 1998.).
Beaucoup de mauvaise littérature a été consacrée à dénigrer l’utilitarisme, en lui imputant des préceptes et des affirmations que n’ont jamais soutenues ses défenseurs (Footnote: Cf. Francisco Vergara, « Utilitarisme et hédonisme. Une critique d’Élie Halévy et de quelques autres », Économies et Sociétés , série PE n° 24, octobre 1995, p. 31-60, et, du même auteur, « A critique of Élie Halévy. Refutation of an Important Distortion of British Moral Philosophy », Philosophy (Journal of the Royal Institute of Philosophy), janvier 1999. Ce dernier article peut être consulté en anglais ou en français sur http://www.utilitarianism.com/vergara/halevy.htm. ).
Beaucoup de mauvaise littérature a été consacrée à prétendre fonder une éthique sur l’obéissance aux lois de la nature, au prix de considérations filandreuses dont l’un des ressorts réside dans le glissement illégitime entre deux sens parfaitement distincts du mot loi, qui désigne soit une régularité soit un commandement (voir à ce sujet l’analyse de Francisco Vergara p. 99).
Portée par des générations de commentateurs peu scrupuleux et de commentateurs de commentateurs, la mauvaise littérature acquiert le statut confortable des idées reçues, qui se propagent en échappant à tout questionnement critique. Mais les propositions creuses ou fausses ne deviennent pas vraies à force de répétition. Elles constituent un danger parce qu’elles offrent une ligne de conduite illusoire ou erronée face à des problèmes bien réels. Les invocations de la nature en lieu et place de principes clairs de jugement comptent parmi ces propositions creuses et dangereuses. Espérons que la publication de cet essai de Mill contribue à ruiner le crédit immérité dont elles jouissent.
© Estiva Reus
Billet publié le 01-02-2021 sur le blog du site estivareus.com
Notes
Notes :