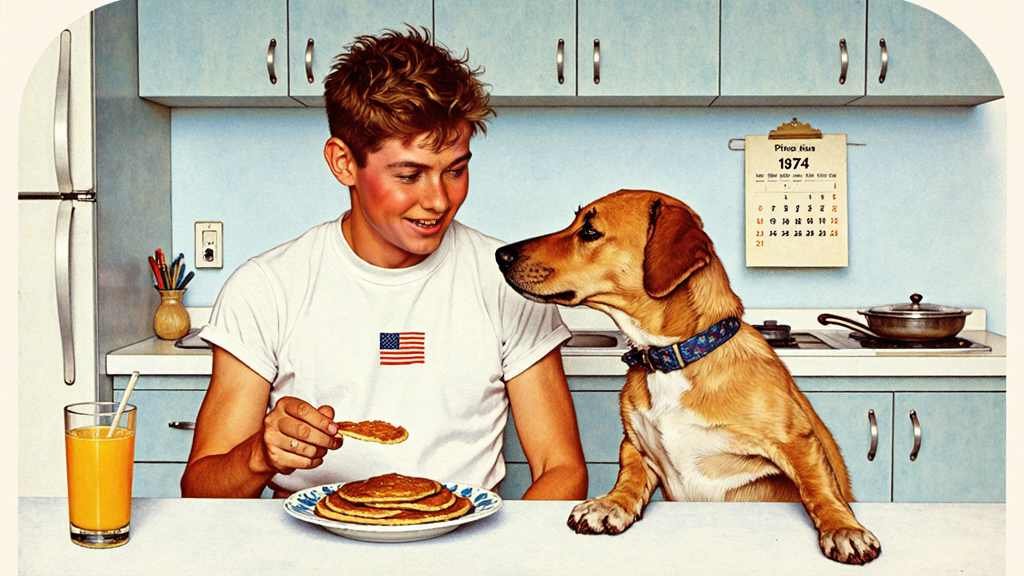Introduction
Matthew Scully est l’auteur d’une pièce remarquable de la littérature animaliste, Dominion : The Power of Man, the Suffering of Animals and the Call to Mercy. L’ouvrage fut largement salué par la critique lors de sa parution en 2002 (Footnote: Des extraits des louanges que reçut Dominion sont reproduites au début des éditions postérieures à 2002. On peut les consulter en feuilletant les premières pages du livre sur le site d’une librairie en ligne.). Il a été depuis réimprimé et reste disponible de nos jours. Il a également été publié en version ebook et audio. En revanche, il n’a pas été traduit dans d’autres langues. Une des raisons en est peut-être son ancrage dans la culture politico-religieuse propre aux États-Unis.
Scully a mis sa plume au service des animaux en bien d’autres occasions, prenant leur défense dans de nombreux articles de presse dont certains ont la longueur d’un essai. On peut s’en convaincre en consultant par exemple la liste de ses publications dans National Review ou dans le New York Times, qui sont loin d’être les seuls médias où il s’est exprimé à ce sujet. Une partie de ses articles sur la question animale ont été rassemblés dans un livre publié en 2023 sous le titre Fear Factories: Arguments about Innocent Creatures and Merciless People. Dans ce livret, après avoir présenté l’auteur, je m’en tiendrai pour l’essentiel à un compte rendu de Dominion.
Un des traits distinctifs de Matthew Scully est d’être un conservateur qui, pour partie, s’adresse spécifiquement au public conservateur, sans toutefois lui épargner les critiques.
Pour autant, son œuvre ne devrait pas laisser indifférent le lectorat de gauche. Parce que Scully est un écrivain talentueux. Parce que les faits qu’il rapporte sont… des faits – des constats dénués de couleur politique. Parce que les sentiments qu’il exprime face à la maltraitance animale peuvent être compris et partagés par beaucoup d’entre nous, indépendamment de nos préférences partisanes. Parce que les propositions qu’il avance pour alléger la souffrance animale rejoignent ce qu’espèrent et revendiquent de nombreuses organisations de défense des animaux. Parce que même les animalistes de gauche les plus attachés à la « convergence des luttes » peuvent faire preuve d’un certain réalisme : avoir conscience qu’il est improbable que l’ensemble de la population se convertisse à leurs vues sur chacune des questions sociales qui les préoccupent ; se souvenir que quand bien même leur nuance de gauche préférée arriverait un jour au pouvoir, il y a habituellement alternance dans les majorités politiques. Dès lors, même des militants animalistes de ce type pourraient être heureux de savoir et de faire savoir qu’il existe une voix moins aversive que la leur pour le public conservateur. Peut-être pourraient-ils même souhaiter que les auteurs de droite engagés pour les animaux deviennent à la fois plus nombreux et plus divers. Car la droite est une vaste demeure et Scully ne saurait représenter à lui seul les sensibilités variées de tous ses occupants.
1. À propos de Matthew Scully
Scully est né en 1959. Il est le benjamin d’une fratrie de 6 enfants. Ses parents, des républicains, étaient abonnés à National Review, une publication animée par des journalistes venant de divers segments de la droite américaine et qui contribue à donner une assise intellectuelle à celle-ci. Cette revue a par ailleurs joué un rôle dans le parcours professionnel de Matthew Scully. En effet, l’opportunité s’est présentée pour lui au début de sa carrière d’y être employé comme éditeur littéraire, et c’est d’abord ainsi qu’il a pu rencontrer des personnalités marquantes du milieu conservateur. Par la suite, il a souvent contribué à National Review en tant qu’auteur. Dans la préface de Fear Factories, il rend hommage aux responsables de la revue qui ne lui ont jamais demandé de cesser d’écrire sur la condition animale, ni d’édulcorer son propos, malgré les récriminations de certains lecteurs dénonçant une « propagande végane » qui aurait plutôt sa place dans la presse « gauchiste » (Footnote: Scully précise que ce n’est pas uniquement dans la presse de droite que les articles traitant de l’exploitation animale et de la souffrance qu’elle cause suscitent des commentaires désobligeants. Il tend à établir la même symétrie à propos des politiques menées par les gouvernements républicains en matière d’environnement ou de protection animale : oui, elles sont très insuffisantes, mais les démocrates de font pas mieux quand ils sont au pouvoir.).
À l’âge de 15 ans, Matthew Scully a décidé de devenir végétarien par égard pour les animaux ; ses parents ont respecté son choix. Vingt-trois ans plus tard, il optait pour le véganisme. En 1998, il épousait la violoniste Emmanuelle Boers, dont il a eu deux fils. Sa femme et ses enfants sont eux aussi véganes.
Scully vit de sa plume en exerçant deux métiers simultanément ou alternativement. Il est à la fois journaliste et rédacteur de discours pour des personnalités politiques. Il a eu l’occasion à ce dernier titre de faire partie des équipes de campagne de plusieurs candidats engagés dans la course à la Maison-Blanche ou visant le poste de gouverneur d’un État. Il a exercé cette fonction auprès de George W. Bush de janvier 2001 à août 2004 (Footnote: Hormis quelques mois en 2002 où il s’est mis en disponibilité pour se consacrer à la promotion de Dominion.). Dans un article paru en septembre 2007 dans The Atlantic sous le titre « Present at the Creation », il décrit la façon dont se déroulait le travail d’équipe pour la confection des discours du président des États-Unis (voir en particulier la section intitulée « The Sirens of Baghdad Are Quiet » et la suivante).
Scully compte parmi les Américains qui préfèrent généralement le Parti républicain au Parti démocrate. Toutefois, cela ne suffit pas à cerner le genre de conservateur qu’il est.
On est certain en le lisant qu’il n’est pas un libertarien, ni un homme qui juge bon de laisser libre cours aux forces du marché en toutes circonstances.
Sans doute trouve-t-il moins à redire aux usages sociaux en place que les réformateurs radicaux, mais cela n’implique pas de sa part un respect aveugle de la tradition car, écrit-il :
Le simple fait que des habitudes, coutumes et penchants soient anciens ne les rend pas nécessairement vénérables. (p.101)
Parfois, la tradition et l'habitude ne sont que cela, des excuses confortables pour laisser les choses en l'état, même lorsqu'elles sont injustes et indignes. (p.314)
En parcourant les écrits de Scully, il est facile de constater les réserves que lui inspire la gauche identitaire – la gauche « woke » : il ne supporte pas ses « théories prétentieuses » du genre ou de la race, son jargon, sa culture du ressentiment, son dénigrement de tout ce qui est occidental ou anglo-américain, et bien d’autres choses encore (Footnote: On le voit notamment dans cet article d’octobre 2020 intitulé « The Animal-Protection Movement Is Everything That ‘Woke’ Activism Isn’t », dans lequel Scully appelle à s’unir autour de la cause animale.).
Je ne saurais dire quelles sont les préférences de Scully dans tous les domaines relevant des politiques publiques, et donc fournir une liste exhaustive de ses raisons de se dire conservateur plutôt que progressiste (étiquettes auxquelles il est au demeurant quasi-impossible d’associer une signification précise). Il a souvent exprimé l’affection et le profond respect que lui inspire George W. Bush, mais d’une façon qui met beaucoup l’accent sur ses qualités personnelles (sa droiture, sa bonté, sa modestie…). On constate la même attention portée aux traits de caractère estimables quand il loue d’autres personnes impliquées dans la vie publique ou les défend contre des campagnes de dénigrement qu’il juge abusives (Footnote: Voir par exemple cet article de Scully sur John McCain, le candidat républicain à la présidence des États-Unis qui fut battu par Barak Obama en 2008. (Scully a participé, en tant que rédacteur, à la campagne électorale du binôme McCain - Palin).).
Il y a cependant au moins un sujet dont on peut affirmer qu’il joue un rôle décisif dans l’ancrage de Scully à droite : il est profondément engagé dans le camp hostile à la libéralisation de l’accès à l’IVG et accorde à cette question une importance capitale (Footnote: Même si tous les républicains ne sont pas opposés à l’avortement et que tous les démocrates n’y sont pas favorables, il y a un écart très net dans les positions les plus répandues à ce sujet entre les sympathisants des deux partis. Les États-Unis diffèrent à cet égard de la France où les positions sur l’IVG ne diffèrent guère entre les électeurs de droite et de gauche et où la remise en cause du droit à l’IVG est pratiquement absente du débat politique.). En 2013, il écrivait :
Au cours des quelque vingt ans où j’ai officié comme rédacteur de discours, la seule condition que j’ai posée avant de louer mes services a été un refus catégorique d’aider un candidat ou un politicien en poste à promouvoir la cause de l’avortement. Parmi les employeurs que j’ai eus au cours de cette période, celui j’ai admiré le plus était un démocrate : feu le gouverneur de Pennsylvanie Robert P. Casey, un grand homme et un valeureux défenseur de la vie qui considérait l'avortement sur demande comme « l'exploitation ultime du faible par le fort », qui voyait l'acceptation totale de l'avortement par son parti comme une erreur tragique et qui m'a parlé, bien avant [la révélation des agissements de] Kermit Gosnell, des personnages répugnants qui exercent le métier d’avorteur pour l'argent.
Ces mots sont extraits d’un essai intitulé « Pro-Life, Pro-Animal » dans lequel Scully s’adresse en priorité à des conservateurs déjà persuadés que l’avortement est un crime, en les incitant à réaliser que les raisons et les sentiments qui les poussent à défendre les enfants à naître (Footnote: C’est Scully qui emploie l’expression « enfants à naître », comme le font en général les tenants du camp pro-vie. Chez les partisans du camp pro-choix, tout comme dans les travaux de biologie, cette formulation est absente : les êtres en gestation sont appelés « embryons » ou « fœtus ».) devraient aussi les pousser à s’engager contre la maltraitance des animaux, et tout particulièrement à refuser l’élevage industriel. Dans ce même essai, on apprend que les convictions de Scully dans les deux domaines sont fort anciennes et profondes :
J'ai découvert la cause du « droit à l'avortement » et le caractère impitoyable de l’élevage industriel à peu près en même temps, à l'âge de 13 ou 14 ans. Ma réaction a été la même dans les deux cas : on ne doit pas traiter la vie de cette façon. Il suffit de regarder les photos des victimes des deux pratiques, de voir ce dont il s’agit vraiment, pour comprendre que, quels que soient les problèmes auxquels les personnes concernées sont confrontées, cela ne peut pas être la solution. L'avortement de routine et la cruauté systématique ne sont pas simplement des faits malheureux comme il s’en produit dans n'importe quelle société ; ce sont des choses foncièrement mauvaises avec lesquelles aucune société juste ne saurait apprendre à vivre. Aussi compliquées, personnelles et émotionnelles que puissent être ces deux questions (et aussi bizarre qu’il soit que la question de la viande et de ses méthodes de production puisse être perçue comme telle), je n'ai jamais entendu, au cours des années qui se sont écoulées depuis mon adolescence, un seul argument convaincant pour expliquer pourquoi les enfants à naître doivent mourir ou pourquoi les animaux doivent souffrir.
Je n’ai pas connaissance d’écrits de Scully dans lesquels il détaillerait pourquoi, selon lui, aucun des arguments avancés en faveur de la liberté d’avorter n’est convaincant. Je relèverai simplement que la façon dont il s’exprime indique qu’il considère les fœtus comme des êtres sentients. Dans Dominion comme dans « Pro-life, Pro-Animal », il parle de « douleur fœtale ». Pour lui, les négationnistes de la sensibilité des enfants en gestation sont comme les négationnistes de la sensibilité animale : des pourvoyeurs de mauvaises excuses qui aident les forts à tourmenter les faibles et à ne se préoccuper que de leurs désirs égoïstes. Tout au plus admet-il que des femmes tentées par l’avortement peuvent se trouver dans des situations réellement éprouvantes, ce qui n’est pas le cas des mangeurs qui veulent simplement satisfaire leur gourmandise ou ne pas déranger leurs habitudes.
Un portrait même succinct de Matthew Scully ne saurait être complet sans indiquer qu’il est chrétien et que les références à la Bible ou à des sources ultérieures de la doctrine chrétienne abondent dans ses écrits. Même s’il connaît les travaux d’éthiciens laïques, il ne s’en inspire guère. C’est du christianisme qu’il tire ses convictions morales et sa grille de lecture du monde. Mais quelle déclinaison de cette religion a-t-elle sa préférence ? Dans une interview donnée après la parution de Dominion, Scully déclarait :
Je n’ai jamais été un pratiquant régulier et ne me suis jamais considéré comme membre d’une Église. J’ai fréquenté des écoles catholiques jusqu’en troisième (ninth grade) et il y a beaucoup de choses que j’admire dans l’Église catholique. Des lecteurs me disent que cette influence transparaît dans Dominion, et si c’est le cas, j’en suis heureux. Cependant, nulle part dans le livre je ne prétends exposer les enseignements de cette Église (ni d’aucune autre) du point de vue d’un adepte.
Il serait malvenu de rattacher Scully à une Église particulière puisqu’il ne veut pas l’être et a certainement ses raisons pour cela. Néanmoins, il est évident qu’il est de culture foncièrement catholique. Dans ses écrits, il mentionne souvent des textes relevant du magistère de l’Église catholique romaine et commente des propos tenus par divers papes de notre temps. On ne trouve chez lui rien d’équivalent se rapportant à d’autres variantes du christianisme.
Avant de passer au contenu de son œuvre maîtresse, il est nécessaire de préciser les limites de la recension qui va suivre. Dominion n’est pas un ouvrage académique (l’auteur tiendrait cela pour un compliment) tout en étant sans conteste l’œuvre d’un homme qui en sait long sur la condition animale et sur ce qui se dit et fait à son propos. Si l’ouvrage est facile à lire, il est impossible d’en faire un compte rendu complet. Cela tient à la longueur du texte (434 pages) mais aussi à son caractère foisonnant. Il y a bien sûr un ou deux thèmes principaux par chapitre, mais il n’est pas rare que l’auteur introduise des digressions. On repère que certains sujets ou prises de position lui tiennent particulièrement à cœur parce qu’ils reviennent à des endroits différents du volume. Il lui arrive assez souvent d’intervenir à la première personne pour partager les réflexions ou sentiments que lui inspirent une situation, un écrit, ou un événement qu’il rapporte.
La recension que vous vous apprêtez à lire omet une partie des faits et idées évoqués par Scully. Elle ne cite pas les noms d’une foule d’auteurs et autres personnalités qu’il mentionne. Elle est impuissante à rendre la qualité de son style d’écriture, alors que celle-ci contribue grandement à capter l’attention du lecteur. J’espère néanmoins que le compte rendu qui suit est assez juste en ce qu’il sélectionne des faits rapportés de façon détaillée par l’auteur, ainsi que les composantes les plus saillantes de ce qu’il révèle de ses pensées et sentiments.
2. Enquêtes sur des pratiques cruelles envers les animaux et les défenseurs d’icelles
Scully ne propose pas un panorama exhaustif des pratiques témoignant du manque de compassion des humains envers les animaux. Parmi celles qu’il évoque, certaines ne sont qu’effleurées (par exemple le piégeage d’animaux à fourrure), tandis que d’autres font l’objet de longs développements.
J’ai sélectionné parmi ces dernières le sous-ensemble que l’auteur aborde sous forme de reportages (Footnote: Ce choix conduit à laisser de côté deux thèmes que Scully examine pourtant de façon assez détaillée. C’est le cas de l’expérimentation animale dont il explore plusieurs facettes, notamment les expériences menées dans le domaine de la zootechnie, ou celles destinées à tester l’innocuité des composants de produits commercialisés – une pratique amplifiée à la demande des environnementalistes, souligne-t-il. L’auteur s’attarde aussi sur le problème des collisions routières avec des cervidés, déplorant qu’on n’investisse pas dans des méthodes non létales pour les minimiser, alors que ces méthodes existent.). Dans les chapitres 2, 4 et 6 de Dominion, il rapporte ce qu’il a observé en étant présent quelques jours dans des lieux emblématiques de trois formes d’exploitation animale (chasse de loisir, chasse à la baleine et élevage industriel). Si vous lisiez ces chapitres in extenso, vous verriez que Scully a l’art de nous donner l’impression d’être nous-mêmes sur place : on visualise les scènes, on entend parler des gens, on devine le ton et l’allure qu’ils ont ; souvent on connaît leurs nom et qualité. Vous verriez aussi comment Scully s’y prend pour tenter d’amener le lecteur à partager ce que lui-même a éprouvé en visitant ces lieux. On ne trouvera ci-après qu’une version réduite des faits constatés et commentés par Scully à l’occasion des trois enquêtes menées in situ.
2.1. Une convention du Safari Club International (1999)
Le Safari Club International (SCI) est une puissante organisation de chasseurs basée aux États-Unis. En janvier 1999, Scully assiste à sa 27e convention annuelle qui se déroule sur plusieurs jours au parc des expositions de Reno, dans le Nevada.
L’événement se présente d’abord comme une vaste foire commerciale. Plus de mille entreprises de chasse y ont leurs stands, mais aussi des taxidermistes, des marchands d’armes, des vendeurs de toute sorte de services et objets facilitant la chasse : des véhicules, du camouflage, des détecteurs de chaleur ou de mouvement, des appâts, des leurres, des moyens de localisation par satellite… Un animal n’a aucune chance d’échapper à un chasseur bien équipé.
Vous pouvez louer les services de chasseurs professionnels pour qu’ils rabattent ou pistent les animaux ciblés, et vous assistent pour que vous n’ayez plus qu’à appuyer sur la gâchette au moment opportun.
Peut-être aimeriez-vous faire immortaliser vos prochaines actions de chasse par des professionnels de l’image. Il y a cinq ou six sociétés proposant ce service parmi les exposants. Celles-ci vendent également des vidéos rassemblant des scènes remarquables de traque et de mise à mort. Au stand de l’une d’elles, une masse de visiteurs sont captivés par le visionnage d’une vidéo intitulée With Deadly Intent.
Nombre d’exposants sont venus vanter leurs parcs de chasse. Celui-là met en avant le fait d’avoir amélioré l’apparence de ses cervidés par sélection génétique. Rien qu’au Texas, 600 entreprises offrent la possibilité de chasser en enclos. La plupart offrent de tirer sur des animaux d’espèces qui existent aux États-Unis à l’état sauvage. Mais quelques-unes permettent aussi de chasser des animaux exotiques sans avoir à quitter le pays. C’est à elles que sont destinés une partie des animaux capturés vivants en Afrique qui arrivent à l’aéroport de Miami.
Il ne manque pas non plus d’exposants offrant des parties de chasse aux quatre coins du monde. Qu’est-ce qui vous ferait plaisir ? Un ours ? Un lion ? Un rhinocéros ? Ici un candidat à l’abattage d’un éléphant avoue qu’il redoute que l’animal charge. Pas de problème, lui répond-on, on vous fera tirer à partir d’un véhicule. Que vous rêviez d’aller tuer des animaux dans le grand-nord ou dans la savane, vous trouverez la formule qui vous convient. À moins que vous ne soyez tenté de partir en Australie pour tirer sur des moutons à partir d’un hélicoptère.
Vous pouvez bien entendu profiter de la convention pour vous procurer le livre des records du SCI où figurent les noms des détenteurs de différents prix dans 29 catégories et des centaines de sous-catégories, et envisager de faire enregistrer un jour vos propres exploits cynégétiques.
À la convention du SCI, on peut également profiter de toutes sortes de nourritures intellectuelles, culturelles et mêmes spirituelles. Des milliers d’animaux naturalisés, oiseaux et mammifères, sont exposés dans une immense galerie. La conférence d’un philosophe de la chasse n’attire pas grand monde, contrairement aux interventions de personnalités comme le général Norman Schwartzkopf. Ce dernier recommande la lecture du livre de James A. Swan In Defense of Hunting (1995) dont Scully cite quelques passages d’une pompeuse nullité (Footnote: Plus loin, dans un passage du chapitre 3 (p. 112-120), Scully taille en pièces un autre ouvrage glorifiant la chasse et les chasseurs : On Hunting (1999) de Roger Scruton, un philosophe conservateur britannique.). Dans les causeries, il est beaucoup question de la nécessité de défendre le noble art de la chasse face aux insanités répandues par des animalistes ou écologistes. Les participants au petit-déjeuner de prière se voient remettre une brochure dénonçant les racines païennes de l’environnementalisme.
Les animations permettent aussi de s’instruire sur des aspects plus pratiques de la chasse. Cet intervenant par exemple rappelle que lorsqu’on chasse à l’arc on tue surtout par hémorragie et dispense ses conseils pour viser de manière à faire saigner abondamment l’animal.
Le SCI est avant tout un lobby d’une efficacité redoutable et la convention une occasion de vanter ses succès. C’est lui qui a obtenu en 1984 la levée de l’interdiction d’importer des trophées d’ours blancs aux États-Unis. Surtout, le SCI a réussi à faire reconnaître sa fondation comme une organisation sans but lucratif dédiée à des programmes humanitaires et à la conservation de la nature, avec les avantages fiscaux afférents. Ce coup de maître s’est accompagné du déploiement d’un discours où la charité envers les défavorisés et la protection de l’environnement semblent être les préoccupations principales du SCI. Le maître mot est devenu « la conservation », non sans souligner combien les efforts de conservation de la nature se conjuguent à un précieux soutien apporté aux communautés locales de pays pauvres : on fait valoir que celles-ci ont la chance de se développer économiquement grâce aux ressources apportées par des chasseurs étrangers, sans compter les services qu’ils leur rendent en abattant de gros animaux qui sans cela menaceraient les cultures. On n’oublie pas d’ajouter qu’en soulageant ainsi la misère, les chasseurs limitent le braconnage. En somme, ce sont des bienfaiteurs des humains et des animaux. Voici la même histoire formulée dans les mots de Scully :
Voici comment la conservation à la manière du Safari Club fonctionne à son meilleur niveau : trois Blancs venus de loin se présentent ; ils prennent à part les chefs locaux et distribuent un peu d’argent tout en faisant miroiter de plus grandes faveurs à venir en échange du privilège de piller les forêts locales. Avant que cela ne devienne de la « conservation », c’est ce qu’on appelait le colonialisme. (p.70)
Les bonnes œuvres dont se prévaut le SCI ne s’arrêtent pas à l’aide au développement. Il se présente aussi comme un organisme au service de personnes handicapées, grâce à la mise en place « safaris sensoriels » : cela consiste à faire toucher à des personnes malvoyantes des animaux naturalisés, ou des parties d’animaux (peaux, crânes, cornes…), afin qu’elles puissent se représenter l’allure de ces bêtes.
À la convention de Reno, des juristes expliquent aux visiteurs tous les avantages qu’ils peuvent tirer du label humanitaire acquis par le SCI. Pensez que les legs à la fondation du SCI ne sont pas imposés. N’hésitez pas à « donner » vos trophées au Musée international de la vie sauvage du SCI, cela vous vaudra une déduction fiscale et les trophées pourront rester chez vous du moment que vous vous engagez à les maintenir aussi bien conservés que dans un musée. Ou bien obtenez une déduction en déclarant qu’une partie de votre maison est affectée à un parcours sensoriel. Personne n’ira vérifier si des enfants malvoyants s’y promènent ou si cet endroit de votre demeure ne sert qu’à vous réunir avec vos amis chasseurs. Tout cela viendra alléger les frais que vous engagez pour vos parties de chasse.
Le récit que fait Scully de sa visite à la convention du SCI est ponctué de passages où il exprime ses propres impressions et sentiments. Il lui semble que le public de l’événement est majoritairement composé de républicains, dont bon nombre de chasseurs nettement plus aisés que l’Américain moyen. Scully circule parmi ces gens réunis autour de leur loisir de mort, qui s’estiment très respectables, qui sont là à se congratuler, et il ne comprend pas.
Au stand où l’on passe la vidéo des plus beaux tirs d’un certain Johan Calitz, les visiteurs s’extasient devant une scène où Calitz et ses acolytes perturbent un groupe d’éléphants et amènent un adulte à charger, lequel s’effondre dans la poussière lorsqu’il est atteint par une quatrième balle tirée par le chasseur émérite. Scully pour sa part s’interroge :
Qu’a ressenti le grand éléphant […] lorsque le salopard s’est pointé, caméra au poing, narguant le troupeau jusqu’à ce que le pachyderme charge et que Calitz puisse nous offrir le spectacle palpitant de ces quatre tirs en pleine tête ? Qu’éprouvent les éléphanteaux, ces petits qui font des cauchemars lorsqu’ils sont emmenés par les tueurs (souvent pour être vendus à des cirques), ou laissés parmi le troupeau avec seulement leurs tantes pour s’occuper d’eux ? Quel genre d'homme prend plaisir à causer de tels tourments, et qui plus est à les filmer pour le plaisir des autres ? Quel genre de raisonnement économique ne permet d’attribuer une valeur à ces créatures que si on les plonge dans un chaos sanglant ? (p. 89-90)
De retour chez lui, Scully éprouve le même sentiment d’incompréhension et de dégoût en parcourant les brochures qu’il a ramenées de Reno (27 kilos de brochures !). Les photos censées attirer les clients représentent des chasseurs fiers ou rigolards posant à côté de leurs victimes mortes ou agonisantes. Scully commente plusieurs de ces photos, dont celle-ci, tirée d’une publicité pour un parc de chasse :
Pourquoi cette femme a-t-elle bien pu vouloir tuer cette girafe, une créature belle et gracieuse qui ne lui a fait aucun mal, qui n’est pas en surnombre, qui ne dégrade pas l’environnement, et qui ne peut même pas prendre la fuite parce qu’elle vit dans un ranch clôturé ? Pourquoi ? (p. 88)
2.2. Une réunion de la Commission baleinière internationale (2000)
La Commission baleinière internationale (CBI) est un organisme créé en 1946 pour réguler la chasse à la baleine. En 1982, la CBI a adopté un moratoire sur la pratique de cette chasse à des fins commerciales. Depuis, quelques pays cherchent à obtenir la levée du moratoire, tandis que quelques autres voudraient parvenir à une interdiction définitive et surtout effective. En effet, La Norvège et l’Islande pratiquent toujours la chasse commerciale. Le Japon fait de même, en prétextant que ses navires harponnent les grands cétacés pour faire progresser la science. Le moratoire en effet ne s’applique pas à la chasse effectuée à des fins de recherche. Il ne vaut pas non plus pour les peuples autochtones qui chassent pour leur propre consommation. En attendant une éventuelle levée du moratoire, ou au contraire son remplacement par des restrictions plus sévères, les réunions de la CBI servent à répartir les quotas de chasse pour les fins qui restent permises. Telle est la situation lorsque se tient du 3 au 6 juillet 2000, à Adélaïde (Australie), la réunion annuelle de la CBI (Footnote: Pour s’informer de ce qui a changé depuis (peu de chose en pratique, si ce n’est que désormais le Japon a quitté la CBI et se livre ouvertement à la chasse commerciale), on peut consulter cet article de Mariam Ghalim publié le 4 septembre 2023 sur le site de la Fondation Droit Animal. Ajoutons qu’en 2024 et 2025, le seul baleinier encore actif en Islande a décidé de suspendre la chasse pour raisons économiques (rentabilité espérée insuffisante).). Scully y est présent en observateur et nous fait vivre la rencontre en une cinquantaine de pages (Footnote: Le chapitre 4 de Dominion contient aussi un historique de la chasse baleinière, ainsi que des informations sur les mœurs des baleines et sur la manière dont elles sont tuées.).
Sur place se trouvent les délégations des pays membres de la CBI, dont la plus nombreuse est celle du Japon (59 délégués), dirigée par Masayuki Komatsu. Du côté des pro-chasse sont présents également des Inuits venus défendre les droits des chasseurs autochtones, des représentants de l’industrie baleinière et des responsables de l’IWMC-World Conservation Trust. L’IWMC est une organisation de lobbying en faveur de diverses formes de chasse et pêche qui est à l’égal du Safari Club International en matière de « conservation de la nature ». Scully dresse un portrait particulièrement peu flatteur de son président, Eugène Lapointe – un homme qui a fait carrière au service des tueurs de grands animaux sauvages.
Des défenseurs des baleines et autres cétacés se sont également déplacés pour faire entendre leurs revendications. Il y a d’abord de simples manifestants, comme ce groupe de jeunes venus de différents pays d’Europe rassemblés autour d’une baleine gonflable. Parmi eux, Simone, 15 ans, ose interpeler au passage M. Komatsu et l’exhorter à mettre fin à la chasse. Scully remarque aussi la ténacité de deux Australiens, un homme à l’allure de hippie et sa compagne. Ils parlent avec beaucoup d’émotion de ce que subissent les cétacés. Pendant les quatre jours que dure la réunion de la CBI, le couple manifeste à l’extérieur des locaux, même quand il pleut. Sont également présents des porte-parole de grandes organisations animalistes ou écologistes. Ce sont elles qui alertent l’opinion publique en diffusant des images déchirantes de baleines poursuivies et harponnées, et en dénonçant des prises illégales. En effet, Scully décrit la CBI comme un organisme faible. Elle n'a pas d’observateurs sur mer ou dans les ports, et elle ne dispose pas de moyens permettant de faire appliquer ses décisions aux pays contrevenants. De plus, explique Scully, une fois une décision adoptée par la CBI, un pays dispose d’un moyen simple de ne pas s’y plier. Il suffit que dans un délai de 19 jours, il remplisse un formulaire indiquant son choix de s’y soustraire.
Une grande partie du chapitre 4 de Dominion est consacrée aux défenseurs de la chasse à la baleine et aux arguments qu’ils déploient. Leurs plaidoyers ne s’adressent pas seulement aux délégations présentes. Ils révèlent la façon dont ces acteurs tentent de gagner l’opinion publique à leur point de vue.
La doctrine de l’industrie baleinière est simple : les baleines sont une ressource naturelle comme une autre. Il est bon de l’exploiter, du moment qu’on le fait raisonnablement (sans épuiser les stocks). Ses représentants déplorent qu’un sentimentalisme niais à propos de ces animaux soit venu perturber ce qui devrait relever uniquement des lois du marché et d’une saine conception de la conservation des espèces (dans l’intérêt des prises futures). Ils regrettent que les opposants à la chasse gagnent des soutiens à leur cause en diffusant des vidéos montrant la traque et l’agonie des cétacés. Oui, ces images peuvent choquer, admettent-ils, tout en s’empressant d’ajouter que ce n’est pas pire que ce qui se passe dans les abattoirs ou quand d’autres animaux sont chassés.
Tout au long de Dominion, chaque fois qu’il est question d’une activité contestée par souci du bien-être animal, on voit revenir encore et encore dans la bouche des défenseurs de l’activité ciblée l’argument – généralement exact – du « pas pire que ». (« Ce que nous faisons n’est pas pire que telle autre pratique causant des souffrances et des morts animales que les contestataires ne remettent pas en cause. »). Si on rentre dans le jeu de la cohérence auquel ils invitent à jouer, aucune avancée pour les animaux ne sera obtenue, car il n’arrivera jamais que toutes les pratiques également nuisibles aux animaux soient simultanément dénoncées avec la même force.
Dans son compte rendu des échanges observés lors de la réunion de la CBI, Scully s’attarde particulièrement sur le cas du Japon qui se montre très inventif pour déguiser sous de nobles motifs une chasse commerciale destinée à satisfaire l’appétit d’une petite minorité de consommateurs nippons. Le pays s’est doté à cet effet d’un Institut de recherche sur les cétacés qui établit les demandes de quotas du Japon en traduisant dans la langue d’impératifs scientifiques urgents les besoins estimés en viande de baleine. En cette année 2000 justement, l’institut a calculé qu’il faudrait sensiblement augmenter les prises pour mener à bien de nouveaux programmes de recherche. Lorsque des biologistes britanniques présentent un exposé soigné dans lequel ils expliquent que la recherche sur les cétacés peut être menée de façon non létale, la délégation japonaise se contente de répondre qu’elle n’est pas de cet avis. D’ailleurs, au besoin de tuer des baleines pour mieux les connaître, l’institut japonais travaille à ajouter une autre raison d’en chasser davantage : les baleines (en réalité, seulement certaines espèces de baleines) mangent des poissons. Il ne faut donc pas laisser proliférer ces mammifères marins qui amputent « nos » ressources halieutiques.
Même si les discussions à la réunion de la CBI restent d’une politesse toute diplomatique, personne n’est dupe : les pseudo-travaux de l’Institut de recherche sur les cétacés ne sont qu’un paravent. Les défenseurs de la chasse à la baleine, avec le Japon en première ligne, ont cependant une autre corde à leur arc : ils font valoir un droit culturel, presque un devoir religieux, de pratiquer cette chasse ; « soudain, on entre dans un territoire sacré ; la raison et l’objectivité doivent être laissées à l’extérieur comme des chaussures. » (p. 189). Honte aux agents de l’impérialisme occidental qui osent contester la tradition séculaire des peuples baleiniers !
L’argument de l’impérialisme occidental agace doublement Scully. D’abord parce qu’il lui semble de mauvaise foi, car bizarrement sélectif. (Il rappelle que le Japon a emprunté à l’Occident des savoirs techniques et des principes d’organisation des institutions, et qu’il s’en est intelligemment servi pour son développement plutôt que de combattre ces apports comme une atteinte insupportable à l’âme nippone.) D’autre part, Scully déplore le fait qu’une certaine gauche (occidentale) soit déraisonnablement perméable à l’accusation d’impérialisme culturel, si bien que les lobbyistes au service des pays désireux de poursuivre la chasse commerciale peuvent habilement manœuvrer en jouant sur ce registre.
Certes, le Japon, grande puissance économique, n'émeut pas grand monde hors de ses frontières quand il est seul à déguiser son obstination à tuer des baleines en lutte contre l’impérialisme culturel occidental. Mais il a compris le parti qu’il pouvait tirer des égards que manifestent les tenants du politiquement correct pour de petits peuples autochtones (Footnote: « Politiquement correct » ou « PC » est l’expression employée par Scully. De nos jours, sans doute parlerait-on plutôt d’idéologie décoloniale. Cet article publié août 2019 sur le site Paris-luttes.info offre un exemple de ce type de sensibilité. Elle est, selon Scully, répandue chez les environnementalistes, de sorte qu’on parvient trop facilement à les neutraliser en s’indignant des traditions piétinées de quelque peuple autochtone. Si vous souhaitez lire un texte de Scully où s’exprime son aversion pour les progressistes qui refusent de dénoncer des pratiques sanguinaires envers les animaux dès lors que leurs auteurs ne sont pas occidentaux, lisez son article « Into the Deep with Seaspiracy », paru le 28 avril 2021.). Scully en donne comme illustration ce qui s’est passé avec les Makah, une tribu amérindienne qui réside au nord-ouest de l’État de Washington. Cela faisait 70 ans que ce peuple avait cessé de chasser la baleine lorsque le conseil tribal décida de renouer avec cette tradition ancestrale, et fit valoir son droit à le faire car le moratoire de la CBI prévoit une exception pour la « chasse rituelle ».
En fait, explique Scully, c’est au Japon qu’a germé l’idée de pousser les Makah à reprendre la chasse. Le projet fut bientôt soutenu par le World Council of Whalers (WCW), une organisation créée en 1997 à l’initiative du Japon et de la Norvège pour défendre l’industrie baleinière. Un bureau du WCW installé en Colombie-Britannique finança un « programme d’échange culturel » avec les Makah consistant à leur enseigner comment chasser, et se chargea de les aider dans des démarches compliquées auprès de diverses agences américaines. L’IWMC se fit une joie de se déguiser à son tour en défenseur des opprimés : « “Le harcèlement des Makah par les défenseurs des droits des animaux”, a-t-on pu lire dans la Conservation Tribune de l’IWMC de M. Lapointe, “rappelle le harcèlement tout aussi véhément des Afro-Américains par d'autres racistes/suprémacistes bien-pensants à l'époque du mouvement des droits civiques dans les années 1960.” » (p. 174). Il y eut des tensions et des violences à l’intérieur de la tribu des Makah entre partisans et opposants à la reprise de la chasse. Et finalement, le Japon et ses alliés remportèrent l’exquise victoire symbolique de faire tuer une baleine par des habitants des États-Unis.
En présentant toute l’affaire comme une sorte de programme pour l’estime de soi des Makah, le Japon a trouvé ses « paysans émancipés » (empowered peasants) […] ils constituent d’excellentes munitions dans la guerre médiatique, tout comme les peuples africains au nom desquels l’industrie de la chasse aux trophées et les industries japonaises de l’ivoire et des « aphrodisiaques » s’efforcent d’étendre la chasse au tigre et à l’éléphant. Après avoir perverti le sens du mot « science », les groupes d’intérêt baleiniers japonais pervertissent à présent le sens du mot « culture » en suscitant de faux mouvements indigènes afin de faire revivre des traditions éteintes, alors que l’industrie baleinière aurait dû mourir il y a longtemps de sa belle mort, puisque la « ressource » elle-même était en train de disparaître et que de nouveaux substituts avaient été trouvés pour sa chair et son huile. (p. 175)
À Adélaïde, Scully discute avec un Inuit venu d’Alaska : Eugène Brower, porte-parole de l’Indigenous Whaling Association. Bien que, contrairement aux Makah, les Inuits aient pratiqué sans discontinuer la chasse à la baleine, Scully n’est pas convaincu que cela suffise à légitimer la permanence de cette pratique chez cet autre peuple autochtone :
Leur argument est qu’il y a au moins cinq ou six mille ans qu’ils chassent la baleine dans les baies et que personne n’a à venir leur dire qu’il est temps d’arrêter. En théorie, le droit international et divers traités interdisent aux Esquimaux de commercialiser des produits issus des baleines. Ils chassent donc uniquement pour se procurer de la viande, nous assure-t-on, et au nom d’une tradition sacrée.
Mais à partir de quand la « tradition sacrée » devient-elle un simple sport ? À l'instar des habitants des Îles Féroé (45 000 personnes jouissant de l’un des niveaux de vie les plus élevés d’Europe) qui massacrent chaque année des globicéphales non parce qu’ils ont besoin de leur viande, mais parce qu’ils en aiment le goût, la plupart des Esquimaux qui chassent la baleine de nos jours ne sont pas des primitifs luttant pour leur subsistance dans les rudes marges de la civilisation. Ce sont de jeunes hommes pour qui cette chasse est une passion et, nous dit-on, un acte d’affirmation culturelle. Ils chassent non parce qu’ils sont obligés de le faire, mais parce qu’ils en ont envie, tout en menant par ailleurs des vies tout à fait civilisées : ils habitent dans des maisons chauffées, conduisent des voitures, des camions et des motoneiges, travaillent sur des plateformes pétrolières, dans des magasins, des usines et des bureaux ; dans le nord de l’Alaska, ils prospèrent notamment grâce à l’industrie pétrolière. M. Brower, le « baleinier autochtone de subsistance » esquimau, m'a donné sa carte avec son adresse électronique, et je doute que l'ordinateur soit installé dans un igloo.
Jusqu’au début des années 1970, la chasse à la baleine était en voie de disparition dans ces communautés. Le pipeline de l'Alaska a eu l'effet pervers de la relancer en accroissant la richesse et le temps libre pour les loisirs. Aujourd'hui, il est difficile de distinguer cette pratique de la chasse au trophée, et en particulier de l'engouement moderne pour la chasse à l'arc, avec la même mise en scène délibérée de passions primitives, la même parodie d'exploit héroïque et le même respect sélectif de la coutume. Il faut utiliser le harpon simple, sans se soucier des baleines qui souffriront davantage, ou qui seront atteintes et « perdues », parce que, eh bien, c’est ainsi que faisait arrière-grand-papa et son père avant lui (Footnote: Le harpon traditionnel ne fait « que » s’enfoncer dans le corps de la baleine. Dans la chasse commerciale, il a été remplacé par le harpon explosif, qui en principe tue plus rapidement et plus sûrement. Comme on peut le lire dans cet article publié sur le site de l’IFAW, le harpon moderne s’enfonce dans le corps de la baleine, puis explose en pulvérisant des pointes à ressort dans sa chair. Cependant, même cette méthode ne garantit pas une mort rapide. Cela dépend de la partie du corps qui est touchée. Un second tir de harpon est souvent nécessaire, et une partie des baleines réussissent malgré tout à prendre la fuite alors qu’elles sont atteintes de très graves blessures. [NdT]). La CBI estime que pour mille baleines tuées par les Esquimaux, plus de cent s’échappent avec un harpon planté dans la tête ou sur le dos, et que parmi ces dernières, plus d’une sur quatre est une femelle enceinte. En revanche, la tradition sacrée reste en quelque sorte muette à propos des hors-bords, des tronçonneuses, des radios CB, des avions de repérage et des engins à seize roues que les baleiniers « aborigènes » typiques utilisent à présent pour tirer leur proie hors des eaux. (p. 176)
Les progressistes jugeront sans doute que Scully surestime le bien-être économique des peuples autochtones, et sous-estime les difficultés sociales ou le manque de reconnaissance dont ils souffrent encore. On peut néanmoins créditer l’auteur de Dominion de ne pas utiliser un double standard à propos des traditions, quand elles ne sont que cela (des pratiques héritées du passé qui ne répondent pas ou plus à une nécessité) : si l’argument de la tradition n’est pas moralement recevable pour justifier des pratiques occidentales, pourquoi le serait-il s’agissant des coutumes des non-occidentaux ?
Lors de la réunion de la CBI à Adélaïde, quelques pays tentèrent encore une fois de restreindre la chasse commerciale à la baleine en dénonçant les échappatoires utilisées pour la perpétuer. Encore une fois, ils échouèrent faute d’avoir recueilli les voix d’un nombre suffisant des nations membres de la commission. L’échec était d’autant plus prévisible que le Japon s’était assuré d’une issue favorable en achetant les votes de petits pays – des pays qui n’ont pas d’intérêt à chasser les baleines, mais qui ont rallié le camp pro-chasse en échange du versement d’aides destinées à leur développement économique. « C’est ainsi que les votes achetés de six nations favorables à la chasse à la baleine (Saint-Vincent, Grenade, Dominique, Saint-Kitts, Antigua et Sainte-Lucie) représentant un demi-million de personnes ont contrebalancé les votes de six nations opposées à cette chasse (États-Unis, Grande-Bretagne, Nouvelle-Zélande, Australie, Espagne et Brésil) représentant un milliard de personnes. » (p. 173)
Les manifestants venus dans l’espoir de sauver les baleines sont terriblement déçus. La compagne du hippie pleure. À la fin du chapitre 6 de Dominion, Scully rapporte ce que lui a dit Eugène Lapointe quand il s’est entretenu avec lui : une longue tirade où ce dernier explique que le pire crime contre la nature est de gaspiller les ressources, pas de les utiliser, et que cela vaut pour les éléphants, les baleines et tous les autres animaux – ce principe ne souffre aucune exception. Lapointe a poursuivi en déplorant la fâcheuse tendance à humaniser les baleines, à raconter qu’elles chantent, qu’elles sont intelligentes, et autres inepties qui indiquent simplement que les gens ne les connaissent pas. Idem pour les dauphins que « la plupart des études scientifiques qualifieraient d’animaux stupides » (p. 188), selon Lapointe. Et ce dernier de s’indigner de la « propagande » orchestrée par les associations animalistes qui désignent des méchants pour mieux récolter des dons, en filmant des scènes où des baleines sont harponnées, des dauphins pris dans des filets, ou « des éléphants tués avec l’éléphanteau à côté qui fait des bruits et tout ça » (p. 189). Vous auriez dû voir l’expression de mépris sur le visage de Lapointe pendant qu’il pérorait ainsi, commente Scully, qui conclut en exprimant la profonde antipathie que lui inspire cet homme :
C’est un marchand de mort qui, d’un geste de la main, déclare des groupes entiers de baleines et d’éléphants indignes de vivre et « ne souffre aucune exception ». Il considère avec dédain ceux qui, comme Simone et ses amis, on fait de la baleine un « dieu » – lui qui déborde de projets lucratifs de vente d’ivoire et de graisse, et qui maintenant est animé par ce rêve lilliputien de « stratégie universelle pour les cétacés » visant à contrôler, limiter en nombre et tuer les baleines. Et quel dieu lui inspire cela ? Quoi que les baleines puissent bien exprimer avec leurs sifflements et les éléphanteaux avec leurs « bruits et tout ça », il y a plus de vérité et de bonté dans ces sons que dans tout ce que cet homme a à dire ; de toutes les positions qui s’affrontent ici, je pense que c’est de celle du hippie et de la femme en pleurs que je me sens le plus proche. (p. 189-190)
2.3. À la découverte de l’élevage porcin en Caroline du Nord (2001)
En janvier 2001, Scully consacre quelques jours à rencontrer des acteurs de l’élevage porcin en Caroline du Nord. Cet État abrite alors 10 millions de cochons (plus que d’habitants humains) – des cochons invisibles sauf quand on croise une bétaillère. Le paysage comporte de nombreux bâtiments d’élevage. Les exploitations, qui hébergent chacune des milliers de bêtes, sont à l’origine des « lagunes », des mares de lisier, sources de graves nuisances. Il arrive périodiquement que le contenu des lagunes se déverse dans les rivières, entraînant la mort de tous les poissons. Quand on parcourt le territoire d’une ferme porcine, on découvre qu’outre une lagune, il comporte une fosse dans laquelle sont jetés les cadavres des cochons qui n’ont pas survécu à leurs conditions de détention, ou qui ont été tués sur place comme les porcelets chétifs claqués contre un mur ou les bêtes atteintes de pathologies qui les rendent impropres à la consommation.
Le premier jour de son enquête, Scully n’apprend rien de tout cela. En effet, il a tenté la méthode consistant à rouler dans la campagne et à s’arrêter au hasard dans des fermes pour demander à visiter les élevages et à s’entretenir avec les fermiers. C’est un échec total, non parce qu’on lui refuse l’entrée, mais parce qu’à chaque fois, il ne trouve personne à qui s’adresser. Plus loin dans le chapitre, on comprend pourquoi il en est ainsi. Dans les élevages industriels, beaucoup de tâches sont automatisées, comme la distribution de nourriture. Des travailleurs restent nécessaires, mais ceux qui interviennent ne sont que des passants chargés d’effectuer un certain type de tâches sur différents sites de production, par exemple des inspecteurs venus vérifier que le cahier des charges est respecté ou des transporteurs venus charger les animaux pour les conduire à l’abattoir.
Scully réussit finalement à réaliser des entretiens et à visiter des élevages en contactant les sièges de groupes sous le contrôle desquels sont placés une série de sites de production. Même alors, il ne rencontrera jamais sur place les propriétaires de ces sites. Avec l’industrialisation, c’est comme si les détenteurs des fermes étaient devenus des étrangers sur leur propre exploitation.
Mais comment l’élevage est-il devenu industriel dans cet État de l’est des États-Unis ? Un fermier de Caroline du Nord, Wendell Murphy, est crédité de la mise au point de l’élevage en confinement sur caillebotis. Son projet était de transposer à l’élevage porcin ce qui avait déjà été accompli pour l’élevage de volailles. Il mit au point la technique pour le faire, connut la prospérité et fit en parallèle une carrière politique. Son affaire, Murphy Family Farms, passa sous le contrôle de Smithfied Foods, le plus grand producteur mondial de cochons, en 1999.
Selon un schéma similaire, Smithfield a racheté d’autres groupes d’élevage industriel qui contrôlent chacun une série d’exploitations porcines. Désormais, les fermiers sont des franchisés. Ils possèdent la terre, les bâtiments et les équipements nécessaires à leur activité, laquelle doit respecter strictement les normes extrêmement précises édictées par Smithfield, que ce soit concernant la conception des bâtiments, la conduite d’élevage ou l’alimentation donnée aux cochons. Smithfield vend aux franchisés les équipements qu’ils sont tenus d’utiliser pour se conformer aux normes. En outre, la société Smithfield Foods possède les abattoirs et les usines de transformation de la viande, et distribue plusieurs marques connues de produits issus des cochons.
Les éleveurs porcins indépendants ont quasiment disparu. Ils ne sont pas compétitifs face à un système de production à grande échelle qui ne recule devant rien pour comprimer les coûts au maximum. De plus, dans les périodes où l’aval est trop sollicité par rapport aux capacités, les éleveurs indépendants sont les derniers à pouvoir envoyer leurs bêtes à l’abattoir.
Dans le chapitre 6 de Dominion, Scully rapporte ce qu’il a appris en rencontrant les dirigeants de deux groupes rachetés par Smithfied : Sonny Faison, directeur de Carroll’s Foods, et Jerry Godwin, président de Murphy Family Farms. Le contraste est saisissant entre le propos de ces hommes et ce qu’il découvre en visitant des élevages. Faison et Godwin sont des notables, conscients du pouvoir que leur confère le poids de leur activité dans l’économie de la région. On le sent à leurs manières, à l’assurance avec laquelle ils s’expriment, et aussi au décor dans lequel ils travaillent. Leurs bureaux sont ce qui se fait de mieux dans le monde des affaires : confortables, lumineux, garnis d’un mobilier coûteux.
Faison et Godwin (que Scully rencontre séparément) vantent les qualités de leur organisation de la production : l’élevage à l’ancienne est dépassé ; chez eux, tout est basé sur la science ; ils emploient beaucoup d’experts ; leurs produits sont élaborés de façon à offrir une qualité excellente et uniforme ; la traçabilité est garantie ; ils répondent parfaitement aux attentes des consommateurs… Dans le bureau de Sonny Faison, Scully se risque à soulever la question du bien-être animal.
« Je comprends les aspects économiques de l’élevage de masse en confinement », dis-je à Sonny. « Et je reconnais que si une entreprise doit tuer un million de porcs tous les douze jours, il n’y a pas de façon douce de le faire. Mais, d’homme à homme, ne trouvez-vous pas qu’il y a quelque chose d’un peu triste à enfermer ainsi des millions d’animaux ? »
« Ils aiment ça », répond Sonny.
« Vraiment ? »
« Oui, ils aiment ça. Ça ne les dérange pas du tout. Ils sont confinés dans des installations ultramodernes. Les conditions dans lesquelles nous maintenons ces animaux sont beaucoup plus humaines que quand ils étaient dehors dans les champs. Aujourd’hui, ils sont logés dans un environnement contrôlé à bien des égards. La nourriture est à leur disposition en permanence, de même que l’eau, de l’eau potable. On s’occupe très bien d’eux, car plus un animal est satisfait et en bonne santé, mieux il grandit. » (p. 258-259)
Même son de cloche lors de l’entretien avec Jerry Godwin, qui se présente lui-même comme un conservateur et qui est sans nul doute un chrétien pratiquant respecté dans sa communauté. Godwin insiste sur le fait qu’il préside une entreprise et que l’affaire doit être conduite de façon à dégager des profits. Pour autant, selon lui, c’est une erreur de croire que les animaux sont maltraités dans les exploitations de grande taille. Ils jouissent d’un certain confort et sont à l’abri des intempéries et des piqûres de moustiques. De plus, sa société fait appel à des consultants en bien-être animal comme Temple Grandin. Quand ces experts conseillent d’enrichir l’environnement des cochons, ils suivent leurs recommandations. Par exemple, ils mettent un morceau de chaîne à la disposition des porcs pour qu’ils puissent s’amuser avec. « Ce n’est pas différent de les laisser sortir et mordre une branche d’arbre. » (p.281)
Sonny Faison accède à la requête de Matthew Scully de visiter des élevages. La seconde exploitation dans laquelle il le conduit, la ferme 2149, réalise toutes les étapes de l’élevage : naissage, post-sevrage et engraissement. Quand Faison et Scully arrivent sur le site, la seule personne présente est un certain Roberto (c’est écrit sur son badge) qui est incapable de répondre à la moindre question, car il ne parle pas un mot d’anglais. Roberto est représentatif de la main-d’œuvre non qualifiée employée dans l’élevage industriel. En Caroline du Nord, la population d’origine latino-américaine a connu une croissance fulgurante, car la filière porcine emploie beaucoup de travailleurs étrangers, avec ou sans papiers.
Pour faire fonctionner nos fermes industrielles et nos charniers modernes, il faut des gens prêts à faire le travail démoralisant que cela exige. En Amérique, nous nous sommes tournés vers nos frères du Sud. […] Il y a longtemps que les usines de conditionnement recourent au travail non qualifié d’immigrés, mais ce n’est que depuis peu que leurs services sont également requis dans les élevages. Ils font de bons « associés ». Ils ne posent pas beaucoup de questions. Ils ne créent pas de syndicats ou autres choses absurdes de ce genre. Ils restent entre eux, surtout les clandestins, et ne créent pas d’ennuis. En général, ils ne connaissent rien aux cochons ou autres animaux de ferme. Mais qu’est-ce que cela peut bien faire quand il n’y a ni troupeaux à garder ni soins à prodiguer aux bêtes ? Tout ce dont on a besoin, c’est de gens qui travaillent dur, de gens qui n’ont pas le choix, de gens si pauvres et désespérés que toucher sept ou huit dollars de l’heure pour trancher des gorges ou remplir des fosses de cadavres leur semble être une chance à saisir. (p. 262)
À la ferme 2149 où se sont rendus Faison et Scully, Roberto s’est éclipsé après la tentative infructueuse de dialogue. Faison, qui doit retourner au bureau, passe un appel afin que quelqu’un d’autre vienne sur le site et serve de guide à Scully. C’est ainsi que ce dernier rencontre un de ces experts que les maîtres des fermes usines se vantent d’employer afin que les élevages appliquent le meilleur des méthodes modernes. Son accompagnatrice sera une jeune femme prénommée Gay.
Elle se présente : elle a récemment obtenu son doctorat d’animal science (c’est ainsi que se nomme la filière universitaire où l’on étudie la zootechnie) ; elle a obtenu un emploi de « scientifique agricole » dans le groupe Smithfied Foods ; elle adore les animaux ; elle adore son travail. Gay répondra obligeamment aux questions de Scully tout au long de la visite. Je ne retracerai ici que l’étape où Scully et son accompagnatrice parcourent le bâtiment abritant les truies gestantes. Les éléments du dialogue entre Gay et Scully figurant ci-après ne sont pas tous des citations exactes (pour éviter des longueurs) mais restent très proches des propos échangés (Footnote: Pour qui voudrait se reporter à l’original, signalons que le passage sur les truies gestantes de la ferme 2149 se situe p. 265-269 de Dominion.).
En entrant dans le bâtiment, où règne une puanteur épouvantable, Gay souligne qu’on y maintient les truies bien au chaud, et qu’elles n’ont pas à souffrir des caprices de la météo. « Les cochons sont très intelligents, aussi intelligents que des chats ou des chiens, ai-je lu dans un magazine », ajoute-t-elle un peu plus tard.
Il y a là environ 600 truies, logées dans six rangées de cages métalliques minuscules où elles restent enfermées 16 semaines, avant d’être transférées dans les cages du bâtiment de maternité. On les réforme (c’est-à-dire qu’on les envoie à l’abattoir) au bout de huit portées, précise Gay. En passant devant la cage NPD 88-308, Gay lance affectueusement à son occupante : « Ça va être ta première mise bas, pas vrai ma chérie ? ». Sa « chérie » est couverte de sang et d’excréments ; elle s’occupe à mordre comme une maniaque la chaîne mise à sa disposition pour « enrichir son environnement ». Scully fait remarquer que la truie se blesse la bouche en tirant sur la chaîne. « Oh, c’est normal ! », dit Gay.
Toutes les truies ont des plaies ouvertes sur le corps. « C’est probablement des blessures dues aux cages » conjecture Gay.
On devine l’âge des truies à leur comportement. Celles ainsi encagées pour la première fois sont éveillées et craintives. Elles grognent et tentent (en vain) de reculer quand on les approche. Celles qui ont déjà connu plusieurs cycles de gestation sont comme éteintes, vaincues ; elles ne réagissent pas, même quand on les touche. Dans quelques-unes des stalles, il a des truies mortes.
« Mais comment parviennent-elles à se coucher sur le flanc ? » demande Scully voyant l’étroitesse des cages. « Ma foi, je n’en sais rien, avoue Gay, le fait est qu’elles y arrivent. » L’explication est pourtant sous leurs yeux. Beaucoup de truies ont des pattes enflées. Faute d’exercice, leurs membres sont fragiles et peinent à supporter le poids imposant de leur corps. Des fractures et entorses surviennent fréquemment, notamment parce que les truies essaient de se coucher sur le flanc en glissant leurs pattes dans la cage voisine. Il arrive alors facilement qu’une patte soit écrasée ou cassée.
La moitié des animaux présents dans le bâtiment ont des membres foulés ou fracturés. Aucun soin ne leur est prodigué pour y remédier. Des vétérinaires passent pourtant régulièrement dans les élevages, mais ce sont des employés de Smithfied dont la mission se borne à traiter les pathologies qui nuisent à la rentabilité de l’exploitation. Les truies reproductrices ne sont soignées qu’en cas de maladie portant atteinte à leur fécondité. Et encore : si la truie est « vieille » (trois ou quatre ans), on jugera souvent plus économique de l’envoyer tout de suite à l’abattoir plutôt que d’engager les frais nécessaires à sa guérison. Par leur façon d’exercer, ces vétérinaires trahissent la mission propre à leur profession, juge Scully. L’un d’eux le fait aussi en soutenant sans sourciller que les animaux ne souffrent en rien des conditions de l’élevage industriel :
Selon Paul Sundberg, vétérinaire et vice-président du National Pork Producers Council, « que les truies soient logées en stalles individuelles ou en groupe n’est pas un facteur déterminant de leur bien-être. L’important est que le système utilisé soit bien géré. La science nous apprend que la truie ne semble même pas savoir qu’elle ne peut pas se retourner […]. Elle veut manger et se sentir en sécurité, et elle peut très bien le faire dans une stalle individuelle. » (p. 271)
La truie de la cage NPD 45-051 présente une énorme grosseur sur la cuisse. « C’est une tumeur, explique Gay. La truie sera tuée dès qu’elle aura mis bas Toutefois, il est à est à craindre qu’elle meure avant la naissance des porcelets. »
Scully s’inquiète d’apercevoir une grosseur (moins volumineuse) sur le corps d’une autre truie. « Une tumeur aussi ? » « Non, le rassure Gay, ce n’est qu’une poche de pus. Elles en ont toutes. »
L’occupante de la cage NPD 41-132 va être réformée bien que très jeune encore. Au début de sa carrière de génitrice, elle répondait particulièrement bien au traitement destiné à accroître la fertilité. Elle a mis au monde 18 porcelets à sa première mise bas, et 13 à la seconde. Mais maintenant, elle maigrit et fait des fausses couches. Il est temps qu’elle devienne jambon et côtelettes.
Un morceau de pneu pend au bout d’une ficelle au-dessus de la stalle NPD 88-283. C’est le seul objet de ce type présent dans tout le bâtiment, et il est placé de telle sorte que l’occupante de la cage ne peut pas l’atteindre. Temple Grandin recommande de donner aux porcs des objets doux et flexibles à manipuler. Scully soupçonne fortement que le bout de pneu n’est là que pour permettre aux responsables de l’élevage de prétendre qu’ils suivent les conseils de la consultante en bien-être animal, voire d’affirmer que leurs animaux sont plus heureux que jamais grâce à leurs jouets.
Nous continuons à marcher. Partout, des plaies, des tumeurs, des ulcères, des poches de pus, des lésions, des kystes, des ecchymoses, des oreilles déchirées, des pattes enflées. Des grognements, des gémissements, des morsures de queue, des bagarres et autres « vices », comme on les appelle dans l’industrie. Mâchonnement frénétique de barres et de chaînes, mâchonnement stéréotypé « à vide » de rien du tout, creusement stéréotypé et construction de nids avec de la paille imaginaire. Et de la « défaite sociale », beaucoup de défaite sociale, toutes les trois ou quatre cages, un être complètement brisé dont vous savez qu'il est en vie uniquement parce qu'il cligne des yeux et vous regarde comme la pauvre NPD 50-421, des créatures que la pitié ne peut aider ou que l’indifférence ne peut rendre plus malheureuses, mortes au monde sauf en tant qu’amas de chair dans lequel la tige d’insémination artificielle peut être enfoncée une fois encore afin de reproduire plus de chair. (p. 267-268)
Tout le reste du récit par Scully de l’enquête menée en Caroline du Nord a la tonalité des séquences que l’on vient d’évoquer. D’un côté, la réalité d’animaux prisonniers d’un système incroyablement cruel. De l’autre, le discours des créateurs et gérants de ce système qui présentent chaque privation, chaque mutilation, chaque violence faite aux bêtes comme une mesure mise en place pour le bien des cochons. Au minimum, ils assènent qu’il n’y a pas d’alternative : leur organisation de la production est la seule qui soit viable, la seule à la fois rationnelle et scientifique. Si tant est que quelque chose ne soit pas optimal dans la vie des cochons, c’est la faute des exigences des consommateurs, des attentes des actionnaires, de la variabilité de la météo ou de l’agressivité des moustiques. Eux n’y sont pour rien.
2.4. Les négationnistes de la conscience animale
Dans Dominion, Scully évoque et conteste la plupart des arguments fréquemment opposés aux végétariens ou aux défenseurs des animaux, du sacro-saint principe de la liberté individuelle de chacun (de porter de la fourrure, manger de la viande…) jusqu’au reproche de détourner les ressources et l’affection qui devraient être réservées aux humains dans la misère. L’auteur évite en la matière de recourir au « style FAQ » d’un catalogue de réponses apportées à une liste d’objections. Il procède avec grâce, en insérant des commentaires, parfois réduits à des piques d’un humour féroce, dans le récit de divers événements.
Un argument récurrent, illustré par les propos de différentes personnes rencontrées ou citées, est celui de la sensiblerie ou du sentimentalisme déplacé dont souffriraient les animalistes, tandis que leurs opposants sont invariablement décrits comme des gens lucides, qui savent user de la raison, et qui connaissent la vraie vie.
Dans tous les cas, les objections soulevées ont pour but ou pour effet d’effacer les animaux, de détourner l’attention vers autre chose que les sévices qu’on leur inflige. Les pourfendeurs du sentimentalisme peuvent ainsi s’avérer intarissables sur leurs propres émois gastronomiques ou cynégétiques, indice que pour eux l’émotion n’est méprisable que lorsqu’elle bénéficie aux animaux.
Scully traite avec un soin particulier l’accusation d’anthropomorphisme portée contre les défenseurs des animaux : ces derniers attribueraient à tort aux bêtes des sensations et émotions que les humains sont seuls à connaître – une erreur qui conduirait tout droit à la sensiblerie.
Le chapitre 5 de Dominion est entièrement consacré à la littérature relative à l’intelligence et aux sentiments des animaux. L’auteur y cite de nombreuses études qui ont mis à jour des comportements et capacités remarquables chez diverses espèces. Un passage de ce chapitre évoque la personnalité et les travaux de Temple Grandin, une femme qui sait reconnaître la détresse animale et qui, sans remettre en cause la production de viande, avance des propositions concrètes d’aménagement des conditions d’élevage et d’abattage afin de réduire la souffrance des bêtes.
L’essentiel du chapitre 5 est toutefois consacré à l’exposé et à la critique d’idées défendues par des auteurs contemporains qui sont en fait des négationnistes de la conscience (ou sentience) animale. En langage savant, académique, ils s’emploient à dresser le rempart le plus radical qui soit face à la dénonciation des atrocités commises envers les animaux. Car quel mal pourrait-on bien faire à des êtres qui ne se rendent pas vraiment compte de ce qu’ils vivent ? Trois défenseurs de cette optique sont longuement ciblés par Matthew Scully : Stephen Budiansky, John S. Kennedy et Peter Carruthers (Footnote: Carruthers à propos de son livre The Animals Issue: Moral Theory and Practice (1992), Kennedy pour The New Anthropocentrism (1992), Budiansky pour If a Lion Could Talk: Animal Intelligence and the Evolution of Consciousness (1998). Il est aussi question d’un autre ouvrage de ce dernier, The Covenant of the Wild (1992), dans lequel l’auteur présente la domestication comme un processus évolutif mutuellement avantageux. ).
Comment procèdent-ils ? En posant des conditions à l’existence de la conscience que ne satisfont pas les animaux. Budiansky notamment soutient que la conscience exige la possession d’un langage. Faute de capacités verbales, les animaux ne peuvent pas former de concepts. (On se demande bien comment les bébés humains apprennent à parler, observe Scully. Comment se mettent-ils à prononcer des « mamama » puisque la notion de mère ne renvoie à rien dans leur esprit – ou absence d’esprit – dans leur état préverbal ?)
Chez ce type d’auteurs, l’affirmation de l’inexistence de la conscience animale peut côtoyer des propositions plus faibles. Par exemple, que les animaux ne disposent que du type de conscience d’arrière-plan que nous avons quand nous sommes en « pilotage automatique », comme lorsque nous parvenons à conduire une voiture bien que notre esprit soit absorbé par des pensées sans rapport avec la conduite. (Il est impossible que la conscience animale se réduise à cela chez les animaux, objecte Scully, car eux aussi doivent faire des choix, prendre des décisions, et la torpeur d’une conscience d’arrière-plan n’y suffit pas.)
Une autre proposition encore se trouve juxtaposée à la négation de la conscience animale, bien qu’elle en diffère : l’idée que même si les animaux étaient conscients, il nous serait tout à fait impossible de prouver qu’ils le sont.
Il arrive même à Budiansky de faire mine d’accorder du crédit à l’idée qu’on ne saurait être affirmatif sur la réalité des expériences conscientes des êtres humains autres que soi-même, voire à l’idée que notre propre subjectivité pourrait n’être qu’une illusion. Tout ceci repose d’une part sur des emprunts à des discussions qui ont lieu dans le champ ardu de la philosophie de l’esprit, et d’autre part sur le constat (exact) que le seul vécu subjectif qui nous soit directement accessible est le nôtre propre. Seulement, tant qu’il s’agit d’humains, ces spéculations ne sont qu’un jeu intellectuel. Elles n’invitent nullement à traiter nos congénères comme s’ils étaient dénués de subjectivité. « On appelle “solipsistes” les personnes qui croient cela, et on nomme “psychopathes” les personnes qui agissent comme si c’était vrai. » (p. 222) Il en va tout autrement s’agissant des animaux :
En pratique, M. Budiansky et consorts ne doutent pas de la réalité de leur propre conscience, ni de celle de la nôtre, sans quoi ils n’écriraient pas de livres sur la conscience. La différence est qu’alors qu’ils s’en remettent au sens commun, à l’empathie et à la décence s’agissant de la conscience humaine, ils font l’inverse dans le cas des animaux, en exigeant un niveau de preuve qu’il est impossible d’atteindre […]. (p. 230)
La thèse « si les animaux étaient sentients, il nous serait impossible de le savoir » semble plus modérée que l’affirmation « les animaux ne sont pas conscients », cependant elle fonctionne de la même manière. En pratique, insister lourdement sur l’incertitude conduit facilement à tolérer qu’on traite les animaux comme s’ils ne pouvaient pas souffrir, pour peu qu’on ait quelque intérêt à agir de la sorte. Les fabricants de doute sur la conscience animale sont des alliés objectifs des industries d’exploitation animale. Scully cible particulièrement Budiansky qui atteint un public plus large que les amateurs d’ouvrages savants en s’exprimant aussi par des articles de presse, et qui agit en militant pro-chasse et pro-élevage. L’auteur de Dominion ne cache pas l’aversion que lui inspirent les intellectuels de ce genre.
Il serait injustifié d’accorder autant de place et d’attention à ces théories abstraites si elles restaient dans leur habitat naturel – dans le monde des spéculations théoriques, des énigmes intellectuelles dont on discute à l’université. Le problème réside dans leur application pratique. Ce sont elles qui permettent les actes vicieux commis par les gens envers les animaux. Ici, nous avons un homme intelligent comme M. Budiansky qui s’efforce de prouver, en empilant des conjectures, qu’un éléphant ne connaît même pas sa propre trompe. Pendant ce temps, quelque part en Afrique, une brute fort peu versée en philosophie tourmente et tue un éléphant ; cet éléphant barrit de terreur et de rage tandis que les éléphanteaux se dispersent en poussant des cris, et la loi ne fait rien pour empêcher cela parce que nous ne sommes pas encore tout à fait convaincus que ces créatures souffrent, ou que leur souffrance importe, ou qu’elles sont capables de penser ou de ressentir quoi que ce soit, et ainsi de suite. Je ne sais pas vraiment ce qui est le pire, la mise à mort ou la théorie. (p.229)
3. Sur quoi fonder notre considération pour les animaux ?
« Vous ne trouverez aucune théorie dans ce livre » affirme Scully au chapitre 7 de Dominion (p. 311) – un chapitre dans lequel il exprime ouvertement combien l’éthique animale contemporaine le laisse indifférent.
Pour autant, il n’entend pas négliger les questions de la source ou de la justification des égards dus aux bêtes. Dès le chapitre 1, il s’interroge sur ce qui fonde son attention au sort des animaux. Il mentionne par endroits des événements personnels attestant de sa sensibilité précoce à leur égard, se remémorant par exemple l’émotion ressentie à l’âge de trois ans en découvrant les traces du passage d’un lapin dans la neige : « Quelqu’un était passé par là. Il avait laissé ces empreintes. Il était vivant. Il habitait quelque part dans les environs, peut-être même me regardait-il en ce moment même. » (p. 2)
Toutefois, Scully cherche surtout à exposer des raisons de se soucier des animaux qui ne relèvent pas uniquement de sa psychologie personnelle – des raisons qui valent aussi pour ses lecteurs et, idéalement, pour le reste de l’humanité. Ces raisons, il les trouve pour sa part dans la religion. Le plaidoyer de Scully est de ce fait particulièrement adapté à un lectorat chrétien. À ses yeux, cela n’amenuise pas la portée de son message, au contraire :
… d’un point de vue stratégique, du moins ici, en Amérique, il convient de noter qu’aucune cause morale n’est jamais allée très loin sans faire appel à la conviction religieuse, s’appuyant ainsi sur la sensibilité la plus profonde qui guide l’opinion publique, même à notre époque plus séculière. (p. 12-13)
Il est possible que Scully voie juste s’agissant des États-Unis ou de pays présentant un niveau de religiosité comparable (Footnote: À cet égard, les États-Unis diffèrent assez sensiblement de la France. Même si le mouvement de déchristianisation s’est fait sentir dans les deux pays au cours des dernières décennies, il est beaucoup moins marqué aux États-Unis. Selon une étude menée en 2023-2024 par le Pew Research Center, 62 % des Américains adultes se disent chrétiens, tandis que 29 % ne se disent affiliés à aucune religion (catégorie plus large que celle des seuls athées et agnostiques). En France, selon un document de l’INSEE se rapportant à 2019-2020, 51 % de la population déclare ne pas avoir de religion, tandis que 38 % des habitants se disent chrétiens. Par ailleurs, alors qu’aux États-Unis il est courant de voir des personnalités politiques mentionner Dieu ou faire état de leur foi dans leurs prises de parole publiques, c’est l’attitude inverse qui prévaut en France.). D’ailleurs, au fil des descriptions qu’il livre de promoteurs de l’exploitation animale, on découvre qu’eux aussi s’efforcent de soutenir que Dieu est de leur côté, ou de gagner en respectabilité en affichant leur piété (Footnote: Ce trait est notamment manifeste dans la littérature pro-chasse consultée par Scully – des écrits qui comportent toujours une note mystique censée parer ce loisir de noblesse et de profondeur.).
Indépendamment de la dimension religieuse, l’approche de Scully peut sembler moins étrangère à un public conservateur que d’autres genres de discours circulant dans les cercles animalistes. L’auteur ne pose pas du tout l’égalité en valeur centrale, contrairement à ce qui se fait volontiers dans les milieux de gauche. Il ne demande pas à ses lecteurs de revoir de fond en comble leurs convictions et leur vision du monde avant d’entreprendre d’améliorer la condition animale. Au contraire, il leur assure que cela peut être fait en appliquant sainement des valeurs héritées de leurs pères et qu’ils ont appris à chérir.
Scully est convaincu que son approche est en phase avec ce qu’il y a de meilleur dans le conservatisme. Il est néanmoins lucide sur le caractère navrant de la posture envers la cause animale qui, pour l’heure, prévaut dans les cercles conservateurs.
Nous allons revenir plus en détail sur les points qui viennent d’être évoqués. Il apparaîtra ainsi que le titre Dominion : The Power of Man, the Suffering of Animals, and the Call to Mercy [Domination: le pouvoir de l’homme, la souffrance des animaux et l’appel à la miséricorde] a été judicieusement choisi pour annoncer le contenu de l’ouvrage.
3.1. Dominer avec miséricorde
« J’avoue ne pas être particulièrement pieux ou dévot, écrit Scully, mais les animaux […] ont toujours éveillé en moi quelque chose que je ne parviens pas à exprimer autrement que dans le langage de la dévotion. » (p. 2) Le titre de son livre, Dominion, renvoie à la domination conférée par Dieu aux humains sur les animaux (Gn 1:26). Les conservateurs, observe amèrement l’auteur, sont les premiers à invoquer ce verset, mais aussi les premiers à s’empresser de l’interpréter de travers, en y voyant une permission donnée par Dieu d’utiliser les animaux pour satisfaire nos moindres désirs et caprices. Ceux qui procèdent de la sorte ont le tort, pense-t-il, de réduire la domination au pouvoir. De plus, c’est eux-mêmes, plutôt que Dieu, qu’ils placent ainsi au centre.
Pour Scully (et pour beaucoup de théologiens de notre temps) la domination doit plutôt être comprise comme une mission particulière confiée par le créateur à l’humanité : celle d’être son assistante sur Terre en gouvernant la création conformément à la volonté divine.
Le terme « domination » n’a rien d’insultant pour les autres créatures. Nous avons tous été envoyés dans le monde avec des dons et attributs différents. Les dons des autres créatures, ceux que Dieu a voulus pour elles, sont bons pour beaucoup de choses ; il se trouve simplement que l’art de gouverner n’en fait pas partie. Quelqu’un doit assumer la domination et, quand on regarde autour de nous sur Terre, il semble que nous soyons les meilleurs candidats, précisément parce que nous, les humains, sommes infiniment supérieurs sur le plan de la raison, et que nous sommes les seuls à pouvoir connaître la justice sous une domination encore plus grande que la nôtre. (p. 12)
L’approche de Scully est à beaucoup d’égards semblable à celle que l’on trouve chez d’autres chrétiens animalistes, qu’on les devine de droite ou de gauche, qu’ils aient écrit avant ou après lui. C’est pourquoi je m’en tiens ici à mentionner quelques-uns des éléments qu’il avance pour fonder le respect des animaux sur la foi.
L’auteur s’attache à mettre en valeur les versets de l’Ancien et du Nouveau Testament dont il ressort que Dieu se soucie des animaux, ou les passages de la Bible évoquant ce qu’ils ont de commun avec les humains (tous sont de la poussière qui a reçu le souffle de vie ; Dieu a créé avec soin chacune de ses créatures et les a déclarées bonnes une fois créées ; tous ont été invités à se multiplier ; les animaux aussi étaient partie prenante à l’alliance nouée avec Dieu après le Déluge...) (Footnote: Ceci n’empêche pas l’auteur de mentionner le fait que les chrétiens disposés à user et abuser des bêtes ont aussi leurs passages préférés dans la Bible, et d’avouer qu’il regrette que le Christ n’ait pas été plus explicite sur ce qui est dû aux animaux.).
Scully rappelle que dans le chapitre 1 de la Genèse Dieu donne les végétaux pour nourriture aux humains et aux animaux, ce qui lui inspire ce commentaire :
Si un passage de l'Écriture donne de la crédibilité à ses auteurs, c'est bien celui-ci, car ils n’étaient certainement pas végétariens eux-mêmes. La vision opposée a simplement dû leur sembler inconcevable : un monde dans lequel il aurait plu à notre Créateur de voir ses créatures se traquer, se tuer et s’ingérer les unes les autres. (p. 44)
L’horreur de la prédation et, plus généralement, l’insécurité dans laquelle vivent les animaux sauvages sont évoquées dans plusieurs passages de Dominion. L’auteur note par exemple que « la plupart des animaux à l'état naturel naissent dans des conditions précaires, vivent en perpétuel danger et meurent souvent de façon horrible. » (p. 25)
Scully associe trois idées à ce constat. La première est qu’il ne doit pas servir à noircir le caractère du créateur. Le jardin d’Éden du chapitre 1 de la Genèse montre que la nature que nous connaissons n’est pas celle voulue par Dieu. Par ailleurs, l’Évangile annonce que les tourments propres au monde déchu prendront fin, et que viendra un temps où la souffrance et la mort ne seront plus.
La seconde idée est que ce temps n’est pas venu, et qu’en l’état actuel des choses les humains ne sont pas en mesure de remédier à tous les malheurs : « Mon type de conservatisme comporte une forme élémentaire de réalisme consistant à accepter le fait qu’il y a dans le monde des souffrances qu’il n’est pas en notre pouvoir d’éviter ou d’épargner, en particulier s’agissant des animaux. » (p. 24)
En troisième lieu, Scully s’insurge contre l’argument si facilement invoqué par les acteurs de l’exploitation animale qui prennent prétexte de la naturalité de la prédation pour justifier leurs pratiques cruelles, ou qui s’abritent pour le faire derrière l’idée qu’après tout eux aussi font partie de la nature et se conforment à ses dures lois.
Les humains ne peuvent pas se placer fièrement au-dessus de la nature, en tant que créatures douées de raison et de conscience, tout en prenant la violence et la prédation de la nature comme exemple moral, et ce pour défendre des coutumes et des produits commerciaux dont la plupart d’entre eux admettent volontiers qu’ils ne sont plus nécessaires. Un autre problème soulevé par l’argument « Ils le font aussi » est que, contrairement aux animaux, nous avons à la fois des appétits illimités et des moyens illimités pour chercher à les satisfaire. (p. 45)
C’est un fait que l’humanité tient les animaux en son pouvoir. Au nom de quoi la domination pourrait-elle donc être autre chose que l’exercice le plus brutal et le plus égoïste de la force ? Scully n’invoque ni les droits (au sens philosophique) ni des calculs d’utilité. Pour lui, la source profonde d’un comportement décent envers les animaux ne peut-être que la compassion ou, mieux, l’amour. On pourrait citer de nombreux passages dans lesquels Scully exprime cette conviction ; il y ajoute parfois l’expression du peu de prise qu’ont sur lui les théories académiques qui cherchent à donner un fondement plus formel et savant à nos devoirs envers les animaux. En voici quelques exemples :
C’est le lot des autres créatures, la place qui leur a été assignée dans la création, que d’être complètement à notre merci […]. Les traiter cavalièrement m’a toujours semblé traduire non seulement un manque de générosité, mais aussi une forme de snobisme suprême, comme si leur petite part du bonheur et du chagrin terrestres était sans importance, insignifiante, indigne de l’attention d’un homme, éclipsée par chacun des desseins qu’il peut former à leur endroit, si mesquins, irrationnels ou vicieux qu’ils puissent être.
Ce credo est bien plus subversif que tout ce que l'on peut trouver dans les manifestes de l'environnementalisme ou des droits des animaux, car il ne nous demande pas seulement de conserver, de gérer et de protéger les créatures, mais aussi de leur réserver un peu d'amour. (p. 9)
Parfois, le débat sur le bien-être animal m'apparaît comme un affrontement non pas entre des arguments raisonnés, mais entre des mythologies rivales : d’un côté, « les animaux victimes, opprimés par l'homme », de l’autre, « l'homme conquérant, guidé par Dieu ». À propos des animaux, les êtres humains sont mus par leurs sentiments d’une façon ou d’une autre : soit par le plaisir et l’émerveillement de les voir vivants, soit par le goût pour les ignobles rituels accompagnant leur tourment et leur mort. S’il faut choisir entre des mythes, je prendrai « l’homme comme créature de compassion ». Mieux vaut être sentimental à propos de la vie. (p. 25-26)
Concernant la question des droits des animaux, j’avoue ne guère me soucier de savoir si une doctrine ou une théorie formelle peut-être élaborée pour ces créatures. Il y a des moments où l'on n'a pas besoin de doctrines, où même les droits deviennent insignifiants, où la vie exige une réponse élémentaire de compassion, de miséricorde et d'amour. (p. 287)
3.2. Ni libération, ni antispécisme, ni égalité
Scully a rencontré beaucoup de militants animalistes à l’occasion de la rédaction de son ouvrage. Il évoque à plusieurs reprises dans son livre les campagnes qu’ils mènent, les vérités qu’ils dévoilent en enquêtant sur les lieux d’exploitation animale, les sanctuaires qu’ils créent… Il le fait sur le ton de la gratitude et de l’admiration, rendant un hommage appuyé au travail nécessaire qu’ils font. Il prend aussi leur défense contre des formes répandues de discours visant à les dénigrer. Scully apparaît ainsi comme un supporteur de l’action de ce qu’on nomme habituellement le mouvement de libération animale ou le mouvement des droits des animaux. En revanche, il n’est pas adepte de tout un volet de son langage. C’est un autre angle sous lequel apparaît son peu d’enthousiasme pour l’éthique animale contemporaine, car les termes qui lui déplaisent sont ceux empruntés à celle-ci.
Il mentionne brièvement le mot « libération » dans un passage évoquant ses relations avec le chien de son enfance pour en dire ceci :
J'avais beau essayer, je ne parvenais pas à discerner sur son visage velu le moindre désir de libération. Il voulait seulement se promener autour du lac une ou deux fois par jour, puis rentrer avec moi à la maison, où notre somme totale des plaisirs résidait dans la compagnie l’un de l’autre. […] Il en va de même pour les animaux domestiques en général, qui n'attendent de nous que le respect envers les créatures et les parcelles d'amour que nous avons à leur offrir. (p. 22)
On sent que les dissertations sur le spécisme ne l’inspirent pas non plus lorsqu’il cite avec approbation cet extrait d’un article de Richard John Neuhaus, un clerc qui fut notamment conseiller auprès de George W. Bush sur les questions éthiques :
Comme l’écrit le père Richard John Neuhaus, « la campagne contre le “spécisme” est une campagne contre la singularité de la dignité humaine et, par conséquent, de la responsabilité humaine […]. L’espoir d’un monde plus humain, y compris celui d’un traitement plus humain des animaux, repose sur ce qu’ils [les théoriciens de la libération animale] contestent. » (p. 336)
On peut glaner nombre de passages dans Dominion où, au détour d’une explication concernant un autre thème, Scully insère une phrase destinée à signifier à ses lecteurs qu’il ne lui semble ni judicieux ni exact d’invoquer un principe d’égalité pour défendre les animaux. En voici quelques exemples
Nous devons les traiter avec bonté, non pas parce qu'ils ont des droits ou du pouvoir ou quelque exigence d’égalité, mais en un sens parce qu’ils n’ont rien de tout cela, parce qu’ils se tiennent tous inégaux et impuissants devant nous. (p. xii)
Il n’est pas nécessaire de leur faire quitter leur place et d’exiger une égalité parfaite pour se soucier d’eux, pour voir dans les animaux la dignité morale que seul l’homme peut percevoir, et pour s'abstenir, dans la mesure du possible, de leur faire du mal, comme seul l'homme peut le faire en tant que créature rationnelle et morale. (p. 26)
L'amour des animaux, comme l'amour que nous portons à nos semblables, nous vient en voyant la valeur et la beauté qu’ont les autres indépendamment de nous, en comprenant que les créatures n'ont pas besoin d'être nos égales pour être nos humbles sœurs dans la souffrance, la tristesse et l'histoire de la vie. (p. 247)
Ces déclarations et la citation empruntée à Neuhaus peuvent donner l’impression d’une fausse querelle avec les antispécistes. Scully confondrait égalité descriptive (le fait que différents êtres soient de force égale et disposent des mêmes capacités) et égalité prescriptive (le fait de revendiquer une égale considération pour les intérêts ou droits similaires des êtres sentients). En effet, les tenants de l’égalité animale sont eux aussi conscients que les animaux sont dans un rapport de force défavorable avec les humains. Et la plupart des antispécistes affirment eux aussi que les humains (hors « cas marginaux ») surpassent les autres animaux en rationalité et agentivité morale.
Il existe toutefois une autre interprétation possible à l’assaut de Scully contre l’égalité. Il ne s’agirait pas d’un malentendu avec les antispécistes mais bien d’un désaccord portant sur l’aspect normatif : Scully ne préconiserait pas l’extension aux animaux d’un principe d’égale considération. Ce serait logique, car les autres chrétiens animalistes ne le font pas non plus, y compris ceux qui ont une sensibilité de gauche comme Andrew Linzey ou David Clough. Ces chrétiens affirment que les humains ont une valeur supérieure aux animaux du simple fait d’appartenir à l’espèce humaine sans avoir à batailler avec l’argument des cas marginaux (c.-à-d. des humains dont les facultés intellectuelles et morales sont inférieures à celles d’autres animaux). Ils se retranchent derrière un argument d’ordre théologique : le Christ lui-même a dit qu’un humain valait plus que beaucoup de moineaux :
« Ne vend-on pas cinq moineaux pour deux petites pièces ? Cependant, aucun d'eux n'est oublié devant Dieu. […] N’ayez donc pas peur : vous valez plus que beaucoup de moineaux. » (Lc 12:6-7 S21)
Scully cite lui aussi ces versets de l’Évangile de Luc avant de les paraphraser comme ceci quelques lignes plus bas : « Nous avons “plus de valeur” que les animaux, nous sommes “meilleurs”, mais eux aussi ont une valeur, une valeur propre, et ils ne sont pas oubliés. » (p. 95)
Je m’abstiendrai toutefois d’affirmer qu’on tient-là une différence à la fois claire et à haute portée pratique entre les antispécistes (partisans d’un principe d’égalité) et Scully (partisan d’un principe d’inégalité).
Concernant Scully, peut-être faut-il surtout retenir qu’il n’est pas friand du procédé argumentatif consistant poser en pièce maîtresse un principe très général, pour n’en venir qu’ensuite à ce qui s’en déduirait. Il préfère en appeler à la compassion.
L’énoncé de l’inégalité de valeur entre humains et animaux est bien présent chez lui. Toutefois, il serait sans doute excessif d’affirmer que l’auteur utilise un « principe d’inégalité » comme guide pour parvenir à ses propres recommandations. C’est surtout, me semble-t-il, un homme qui recourt très peu à des systèmes d’inférences à partir de principes ou postulats, et qui se fie plutôt à ses intuitions et sentiments pour détecter que certaines pratiques et certaines attitudes sont condamnables.
Lors d’un échange avec le public organisé par le Washington Post le 25 août 2004, un lecteur, végane de longue date, fait sentir à Scully qu’il a été choqué de lire à la page 398 de Dominion que « La gentillesse envers les animaux n’est pas notre devoir le plus important en tant qu’êtres humains […] », – soit ce qui semble bien être l’une des manifestations de l’idée selon laquelle les animaux importent, mais moins que les humains. En la circonstance pourtant, Scully ne choisit pas de confirmer qu’il a voulu rappeler l’inégalité de valeur des créatures humaines et non humaines. Il fait remarquer à ce lecteur que la suite de la phrase incriminée est « […] ce n’est pas le moins important non plus ». Puis il explique qu’il a voulu dire que d’autres devoirs (aimer son prochain, prendre soin de ses enfants…) sont aussi des composantes essentielles d’une conduite intègre, mais qu’il pourrait formuler la même idée en sens inverse : que quelque chose d’important fait défaut dans la vie des gens qui se montrent cruels ou indifférents envers les animaux, quand bien même ils seraient des modèles de vertu à d’autres égards.
Par ailleurs, tout en refusant explicitement de faire appel à un principe d’égale considération, Scully n’est pas loin de réaliser qu’il ne souhaite pas non plus prendre comme boussole un principe de considération inégale. Au chapitre 1 de Dominion (p. 15-16), l’auteur livre une critique assez sévère des quelques lignes que le Catéchisme de l’Église catholique consacre aux animaux (CEC, § 2415-2418) et notamment de la fin de ce passage, qui énonce ceci :
Il est contraire à la dignité humaine de faire souffrir inutilement les animaux et de gaspiller leurs vies. Il est également indigne de dépenser pour eux des sommes qui devraient en priorité soulager la misère des hommes. On peut aimer les animaux ; on ne saurait détourner vers eux l’affection due aux seules personnes. (CEC, § 2418)
Scully souligne que la prescription d’éviter les souffrances inutiles est tout à fait inopérante, car l’Église n’a pas spécifié quelles pratiques envers les animaux relevaient de ce cas. Pour le sujet qui nous occupe (les discours sur l’égalité ou l’inégalité), c’est surtout cette autre réflexion de l’auteur qui mérite qu’on s’y attarde :
Puisque l’argent que nous dépensons pour les animaux pourrait être destiné à l’objectif prioritaire d’allègement de la misère humaine, pourquoi n’est-il pas toujours indigne de dépenser de l’argent pour les animaux ? Mais comment pourrait-on concilier ce principe, s’il était appliqué sérieusement, avec le principe précédent qui déclare qu’il est contraire à la dignité humaine de faire souffrir et mourir des animaux sans nécessité ? (p. 16)
La remarque est pertinente. Scully ne l’évoque qu’à propos du Catéchisme de l’Église catholique. Mais le problème ne surgit-il pas dès qu’on admet un principe de valeur inégale des humains et des animaux, comme l’auteur le fait par endroits ? Après tout, peuvent arguer les ennemis de la cause animale, tous les efforts déployés pour mettre fin à des pratiques cruelles, ou simplement les soins apportés à nos animaux compagnons, détournent du temps et des ressources qui pourraient être plutôt alloués à secourir des humains dans le besoin – ces êtres qui ont la préséance sur les animaux en raison de la valeur supérieure. Or ce n’est pas la position défendue par Scully.
Peut-être le plus sage est-il de s’en tenir au constat qu’on ne parvient pas à cerner le sens exact des références à l’égalité ou à l’inégalité chez les défenseurs de la cause animale. Le seul point évident est qu’elles ont une fonction de drapeau de ralliement, en affichant des convictions ou des valeurs chères à tel segment de l’opinion. Mais si les revendications du mouvement animaliste étaient satisfaites, y compris celles de la fraction de celui-ci qui invoque l’égalité animale, on resterait à des années-lumière d’une répartition égale des moyens d’accès au bien-être entre humains et non-humains dans les domaines où une distribution plus équitable est possible. Inversement, les supporteurs de la protection animale, y compris ceux qui adhèrent verbalement à l’idée de préséance due aux humains, refusent de fait de réserver les moyens disponibles à soulager la misère humaine.
En pratique, Scully et les autres défenseurs des animaux veulent impulser des améliorations significatives de la condition animale, mais sans que les humains cessent d’être les bénéficiaires privilégiés de beaucoup de protections légales et sociales, ainsi que d’une très grande part des ressources naturelles ou des biens et services produits.
3.3. Peter Singer : aimant et repoussoir
Scully ne s’attarde pas sur les thèses des éthiciens qui ont nourri le mouvement de libération animale. Il cite les noms de Mary Midgley et de Tom Regan, mais ne commente pas leurs travaux. Il mentionne à trois reprises Andrew Linzey, en des termes élogieux, sans toutefois que cela occupe beaucoup de place dans son propos. Il en va différemment de Peter Singer, auquel il consacre des développements dans plusieurs chapitres. Je n’essaierai pas d’en détailler la teneur, car cela conduirait à dériver vers un exposé des thèses de Singer avant d’en venir à ce qu’en dit Scully (Footnote: Citons au moins deux raisons d’éviter la longue discussion qu’impliquerait ce détour. La première est qu’il arrive à Scully de décrire de façon incorrecte la position de Singer, comme quand il lui attribue l’hypothèse « utilitariste » selon laquelle l’homme serait fondamentalement égoïste (p. 329). La seconde est que Scully s’appuie sur les écrits de Singer disponibles à l’époque où il rédigeait Dominion et qu’il faudrait évaluer à quel degré ce qu’il en dit s’applique à des écrits plus tardifs. En effet, Scully commente le Singer qui est un utilitariste des préférences, et celui qui a tracé une ligne de démarcation parmi les êtres sentients entre les personnes et les non-personnes, en particulier dans sa discussion du meurtre avec remplacement. Dans The Point of View of the Universe, un livre cosigné avec Katarzyna de Lazari-Radek, paru en 2014, les auteurs mettent en doute la supériorité de l’utilitarisme des préférences sur l’utilitarisme hédoniste, ce qui fragilise encore plus l’idée qu’il soit pertinent d’établir une distinction (pour évaluer le tort causé par la mise à mort) entre les sentients qui ont des préférences ne portant pas uniquement sur leur futur immédiat (les personnes) et ceux qui ne se projettent pas dans l’avenir, ou seulement à très court terme. Et on pourrait embrouiller encore davantage la discussion en notant que Singer continue de fait à raisonner en supposant que tuer une personne est plus grave que tuer une non-personne, parce que cela correspond à une intuition profonde chez lui.). Sans entrer dans les détails donc, on peut néanmoins retenir que coexistent chez Scully des appréciations ou sentiments contrastés à propos de Singer.
Il rend un hommage appuyé au travail accompli par ce dernier en faveur des animaux. Il reconnaît en lui un auteur qui a joué un rôle capital pour faire connaître l’ampleur des souffrances causées par l’exploitation animale, et qui a proposé des pistes concrètes pour y remédier. Par exemple, il n’a que du bien à dire du Projet grands singes lancé par Peter Singer et Paola Cavalieri en 1993 dans le but de soustraire les singes anthropoïdes à l’expérimentation animale et à d’autres atteintes à leur vie ou à leur liberté. Il trouve d’énormes qualités à La Libération animale, un livre dont il a lu la première édition lors de sa publication en 1975, alors qu’il n’avait que 16 ans, et qu’il a trouvé toujours aussi impressionnant lorsqu’il l’a relu 25 ans plus tard.
Plus exactement, ce que Scully apprécie dans La Libération animale ce sont les chapitres dévoilant la cruauté des pratiques envers les animaux élevés à des fins alimentaires ou utilisés comme sujets d’expérimentations. Par contre, il n’a que faire du cadre analytique proposé par Singer, ni tel qu’il est esquissé dans ce livre, ni tel qu’il est précisé dans ses publications ultérieures. Il regrette que Singer ait entrepris de refonder entièrement la morale selon ses propres lumières là où la morale commune fait l’affaire :
Souvent, quelles qu’en soient les raisons philosophiques, le professeur Singer défendait (et défend toujours) de petites avancées telles que le droit des chimpanzés à ne pas être matraqués ou électrocutés de façon répétée, ou le droit d'un cochon à être laissé « avec d'autres cochons dans un endroit où il y a une nourriture adéquate et de l’espace pour courir librement » (Footnote: Citation tirée du chapitre 1 de La Libération animale (NdT).). Qu'y a-t-il de si radical là-dedans ? (p. 326)
Scully déplore que Singer raisonne comme s’il fallait débarrasser notre culture de l’héritage judéo-chrétien pour construire une éthique digne de ce nom. À ses yeux, le philosophe est condamné à échouer dans cette entreprise : s’il n’y a pas de créateur, l’univers est dénué de sens et il n’y a pas de morale objectivement vraie. On peut brasser dans tous les sens les préférences des êtres sentients, ou invoquer le « point de vue de l’univers » (ce « trône vide » une fois que Dieu en a été expulsé), on bâtit sur des sables mouvants, et on risque de s’égarer gravement.
Sans surprise, Scully estime que c’est ce qui est arrivé à Singer dans ses travaux de bioéthique concernant les humains. Ses prises de position en faveur de l’avortement ou de l’euthanasie lui sont insupportables. Non seulement il les juge détestables en elles-mêmes, mais il estime qu’elles ont nui à la portée de sa parole en faveur des animaux : en défendant la possibilité de mise à mort des enfants non nés, ou des nouveau-nés porteurs de lourds handicaps, ou de personnes en fin de vie, il a été perçu comme un monstre par une partie du public, en particulier chez les croyants, ce qui leur a servi de raison ou de prétexte pour ne pas questionner leur propre comportement envers les animaux.
À seize ans déjà, Scully se souvient avoir diagnostiqué que chez Singer se combinaient la bonté de cœur et une tournure d’esprit excessivement abstraite. Il n’a pas changé d’avis par la suite. On le voit au fil de son livre accoler à Singer nombre d’expressions laudatives (il est bien intentionné, il manifeste un grand courage et une grande intégrité intellectuelle…) tout en insérant de longs commentaires consternés sur la façon dont cet homme trop cérébral a fini par produire des thèses dégradantes pour la vie humaine.
Citons pour finir sur ce chapitre, une des manières dont Scully formule ce qui, selon lui, sépare l’approche de Singer de celle qui a sa faveur :
Le professeur Singer s’exprime dans la langue de l'autonomie, de la souveraineté personnelle, de l'affirmation de soi et de la préférence. Les hommes tout comme les animaux se porteront toujours mieux si nos pensées se centrent sur la compassion, la charité, la bienveillance, la générosité, l'hospitalité et même la pitié, qui a pour noble racine romaine pietas, la vertu et la vision d'où vient la miséricorde. (p. 337)
3.4. La loi naturelle
Au chapitre 7 de Dominion, l’auteur se demande « comment passer du fait biologique “les animaux souffrent” à la proposition morale “il est mal de faire souffrir les animaux” ? » (p. 295). Il soulève plus généralement la question de ce qui pourrait constituer une base solide pour nos valeurs morales. Au fil de sa réflexion, il note que tout le monde n’est pas juif ou chrétien, donc que certains refuseront de fonder leurs jugements moraux sur des références à la Bible. Un sous-ensemble de ceux-là ne sera pas davantage convaincu par les ressources du même ordre qu’on pourrait trouver dans les textes sacrés d’autres religions.
On sait que Scully n’est pas disposé à leur recommander d’opter à la place pour une de ces théories éthiques en « isme » qui circulent à notre époque. Il pense néanmoins trouver une issue en se tournant vers une tradition bien plus ancienne, celle de la loi naturelle, qu’il définit ainsi :
L’idée clé est que toute vérité morale découle de la nature des choses, vraie en elle-même et accessible à la raison sur des aspects essentiels. Chaque être a une nature, et cette nature définit les fins et le bien ultime pour lesquels il existe. En discernant ces fins, nous percevons ce qu'est cet être, ce qu'il peut faire, ce qu'il doit faire pour s’épanouir et se réaliser pleinement, et donc quels sont ses intérêts moraux et comment ils peuvent être favorisés ou entravés. Soudain, tout n'est plus arbitraire ; nous disposons d’un point de référence fixe, d’une base intelligente pour qualifier une chose de bonne et une autre de mauvaise. (p. 299-300)
Scully reconnaît qu’il n’y a pas là de quoi trancher des dilemmes moraux complexes. Il estime néanmoins que cette idée est d’une grande portée. Elle suffit notamment pour condamner nombre de pratiques préjudiciables aux animaux :
C'est aussi simple que de dire que la nature a fait les oiseaux pour qu'ils volent et que nous ne devrions donc pas les élever dans des cages pour ensuite les lâcher selon le bon vouloir de « gentlemen chasseurs » postés pour leur tirer dessus. La nature a fait les éléphants, les girafes et les rhinocéros pour qu'ils habitent les plaines ; nous ne devrions donc pas les tuer, les empailler et les exposer dans nos salles de bal. La nature a fait les baleines et les dauphins pour qu'ils nagent dans les mers loin de l'homme ; nous ne devrions donc pas les traquer à l'aide d'hélicoptères et les attaquer ou les électrocuter à partir de navires-usines jusqu'à ce qu'ils aient presque disparu des eaux. La nature a fait les cochons, les vaches, les agneaux et les volailles pour qu'ils soient élevés par leurs mères, qu'ils marchent, qu'ils paissent et qu'ils se mêlent à leurs congénères ; nous n'avons donc pas à les enfermer, à les torturer et à les traiter comme des machines de notre propre invention. (p.303)
On pourrait relever la formulation fortement téléologique des deux citations précédentes. Certains seront tentés de conclure qu’en fait Scully n’a fait que remplacer le mot « Dieu » par le mot « nature », qu’il dit « nature » en pensant « Dieu », si bien qu’on en reste à un discours qui ne parle qu’aux croyants. Ou bien, sans supposer que la nature sert de déguisement à Dieu, ils pourraient juger aberrantes les propositions avancées, car la nature n’est pas un être intentionnel.
Cependant, la dimension finaliste peut être gommée sans que les propos de l’auteur perdent toute signification. Si on fait disparaître les « fins » et les « pour », il reste l’idée que les animaux ont une existence meilleure quand ils sont dans certains environnements et peuvent exprimer certains comportements, et que les conditions qui leur sont favorables varient selon leur espèce. On n’est pas très loin de ce qu’énonce l’article L214-1 du code rural français quand il prescrit de placer un animal [domestique] « dans des conditions compatibles avec les intérêts biologiques de son espèce ».
Reste à trouver le moyen de passer de ce qui est à ce qui doit être. Comment faire le lien entre le fait que les poulets sont malheureux en élevage intensif et l’idée que les humains ne doivent pas les condamner à une telle vie ? Il semble que la solution de Scully ne consiste pas à tirer une prescription morale d’un fait, mais à tenter de parvenir au résultat en juxtaposant deux faits, ou plutôt le même fait appliqué à des êtres différents.
L’idée est que le bien est une réalité inscrite dans la nature des choses. Scully tient énormément à ce que la morale soit une vérité aussi objective que les réalités physiques. En fait, il aimerait soutenir qu’il suffit d’observer la nature pour connaître la loi morale. Le raisonnement est à peu près le suivant. Les humains comme les animaux s’épanouissent quand ils vivent conformément à leur nature, quand ils peuvent exprimer les comportements et capacités propres au genre d’êtres qu’ils sont. À ce point, pour pouvoir poursuivre le raisonnement, il faut poser que l’essence des humains est d’être des créatures rationnelles et morales.
Nous, les humains, trouvons notre épanouissement ultime dans la bonté morale, en développant pleinement nos capacités et en partageant ces dons avec les autres. Les cochons trouvent leur bonheur en fouissant, en jouant et en se roulant dans la boue. La nature leur a donné moins et a exigé moins d’eux. (p.300)
Et donc, lorsque les humains réalisent pleinement leur potentiel, ils atteignent le summum de l’accomplissement permis par leurs dotations naturelles (leur propre bien) tout contribuant au bien des individus d’autres espèces. Du moins, ils évitent alors de faire obstacle, pour des raisons futiles, à ce que peuvent faire les animaux pour s’accomplir malgré les multiples dangers auxquels ils sont exposés.
Bien qu’il s’en défende, Scully s’aventure ici sur le terrain des théories éthiques et même de la métaéthique. On retrouve un écho de cette incursion à la fin de la préface de Fear Factories (2023), à travers l’énoncé d’une proposition forte : « Quoique l’esprit judéo-chrétien soit d’un grand secours pour plaider la cause animale, ce plaidoyer peut s’appuyer uniquement sur la raison. ». Cette affirmation renvoie implicitement à ce que l’auteur écrivait à ce propos dans son ouvrage de 2002.
Cependant, le passage où il est question de la loi naturelle n’occupe que quelques pages dans Dominion (la section intitulée « Vérités évidentes », p 399-304). On conviendra que c’est trop peu pour susciter l’adhésion au-delà du cercle des personnes déjà favorables à cette thèse (Footnote: Les moins convaincus pourraient objecter que ni de cette manière ni d’une autre, il n’est possible de fonder des prescriptions morales « uniquement sur la raison », si on entend par « raison » la faculté de distinguer le vrai du faux en combinant la connaissance de faits (accessibles aux sciences) et le recours à la logique. Il est toutefois plausible que Scully retienne un sens plus large de ce terme, que la raison désigne chez lui la faculté de penser, d’utiliser son intelligence pour former des jugements ou décider de sa conduite. Quand il parle de s’appuyer uniquement sur la raison, c’est par opposition au cas où l’on recourt aussi à la révélation ou à la foi pour parvenir à des conclusions. Le problème, cependant, est qu’on peut dire de n’importe quelle théorie ou doctrine relative à la morale – et pas seulement de la loi naturelle – qu’elle est le produit de l’usage de la raison au sens large.). Et même s’il avait développé davantage, l’auteur n’aurait pas échappé aux objections : aucune des théories disponibles au sujet de la morale ne fait consensus.
Je m’en tiendrai ici à observer qu’en produisant ce raisonnement, Scully montre sous un autre angle à quel point la tradition chrétienne alimente sa pensée, y compris quand il cherche à s’adresser aux non-croyants. Certes, l’idée de loi naturelle remonte à l’Antiquité gréco-romaine. Mais elle a été reprise et adaptée pour forger la doctrine de l‘Église (Footnote: Quand on parcourt les écrits d’autres intellectuels chrétiens défenseurs des animaux, on réalise que leur façon de penser et de formuler les choses est empreinte de ce même héritage. Ils n’emploient pas forcément les expressions « droit naturel » ou « loi naturelle ». En revanche, on trouve souvent sous leur plume le mot « épanouissement » pour décrire l’état souhaitable où les animaux peuvent exprimer les comportements et capacités propres à leur nature. Lorsqu’au chapitre 1 du volume 2 de son On Animals (2019), le théologien protestant David Clough passe en revue les courants profanes d’éthique animale, c’est l’approche par les capabilités de Martha Nussbaum (inspirée de l’idée d’Aristote de formes d’épanouissement propres à chaque type de créatures) qu’il juge la plus proche d’une compréhension théologique de la vie animale. On pourrait encore citer le théologien catholique John Berkman qui reprend l’héritage néo-aristotélicien de Thomas d’Aquin en le reformulant d’une façon plus favorable aux animaux.). De même, la conception de l’homme comme être essentiellement rationnel et moral que mobilise Scully lui vient naturellement parce qu’elle est une composante de l’enseignement catholique depuis presque deux millénaires. Elle n’est pas d’origine biblique, mais a été intégrée très tôt à la doctrine de l’Église, là encore à partir d’emprunts à des philosophies de l’Antiquité (Footnote: On sait que Scully trouve dans cette conception de l’homme une explication de la domination conférée par Dieu aux humains (la domination revient aux êtres qui sont par leurs capacités spécifiques les plus compétents pour gouverner), alors que la Bible ne fournit aucune explication de cette décision divine. Cet ajout toutefois ne fonctionne pas pour la fraction non négligeable des humains aussi peu dotés en raison que les animaux.).
Ainsi, même lorsqu’il s’éloigne d’un langage ouvertement religieux, Scully tend à faire confiance à des idées validées et retravaillées par les grandes figures intellectuelles du christianisme – des idées inscrites depuis des siècles dans la culture chrétienne –, plutôt qu’à des approches plus récentes développées dans un cadre laïque.
3.5. Les conservateurs à la traîne
La défense des animaux est-elle compatible avec le conservatisme ? Scully ne doute pas qu’elle le soit, tout en constatant la fréquence des réactions hostiles dans les milieux conservateurs qu’il fréquente.
Du côté positif, il relève que la sensibilité ou les valeurs conservatrices devraient naturellement conduire à admettre que les humains ont un comportement indigne envers les animaux et à vouloir y remédier. Les conservateurs sont en théorie plus aptes que quiconque à déceler qu’on est face à une occurrence de « l'éternelle question du pouvoir terrestre et de ses abus, de la corruption à laquelle tout pouvoir entre les mains de l'homme est sujet » (p.101). Dans une interview donnée après la parution de Dominion, l’auteur dit croire que les conservateurs finiront par reconnaître dans l’élevage industriel et autres formes de cruauté « quelques problèmes familiers : relativisme moral, matérialisme égocentrique, licence se faisant passer pour de la liberté, et culture de la mort ».
Du côté positif, il relève aussi que les républicains ne sont pas toujours aux abonnés absents quand il s’agit de faire avancer la cause animale : la moitié des adhérents de la grande association animaliste HSUS seraient républicains. Dans Dominion et autres écrits, Scully cite nommément des élus républicains (mais aussi des démocrates) qui se sont illustrés par leurs prises de parole ou par leurs actions pour améliorer la condition animale. Et dans un échange avec des lecteurs du Washington Post, l’auteur énumère les personnalités conservatrices qui ont réservé un bon accueil à son livre.
Reste que Scully est lucide sur le fait que, globalement, au sujet de la protection animale, l’ambiance est loin d’être bonne dans les cercles conservateurs, et qu’elle est sans doute même encore plus détestable que dans d’autres milieux.
Il relève (p. 382) qu’alors que cela fait 25 ans qu’il parcourt la prose conservatrice, il n’a pas lu une seule fois une critique d’une forme quelconque d’expérimentation animale.
Plus généralement, il observe que les conservateurs ne vont jamais si loin dans l’idolâtrie des forces du marché que face à quelqu’un qui propose de limiter ce qu’il est permis de faire subir aux animaux utilisés dans le cadre d’activités lucratives.
En général, chez les conservateurs, les bêtes et leur bien-être semblent se situer plus bas dans la hiérarchie morale que le droit de propriété et la liberté d’entreprendre. Et, bien sûr, jusqu'à un certain point, il est très sage de se préoccuper de ces droits. Moi-même, en tant que rédacteur occasionnel de discours républicains, j'ai passé de nombreuses heures à transmettre ce credo de l'aspiration humaine à exercer sa créativité sans se heurter à un État présomptueux qui se mêle de tout. Le problème auquel il faut prêter attention, cependant, est que cette même optique peut parfois aller à l'encontre d’une croyance chère aux conservateurs : que l’homme est un agent fondamentalement moral et pas seulement un agent économique, qu’il doit être guidé par la raison et la conscience et non par ses caprices et ses appétits. On constate par ailleurs souvent que les conservateurs et les libertariens abordent les questions relatives à l’environnement et aux animaux à travers leur forme distinctive de sentimentalisme : en étant tournés vers la conquête de la nature plutôt que vers la nature elle-même. (p. 101)
Scully déplore le ton et la suffisance qu’affichent beaucoup de conservateurs lorsqu’on qu’on tente de les alerter sur l’atrocité des conditions de vie et de mort des animaux soumis au bon vouloir des humains. Ils manifestent alors « une sorte de snobisme exaspéré, comme s’ils ne devaient même pas avoir à se préoccuper de ces questions insignifiantes » et dérivent vers une attitude dogmatique caractérisée par « le manque de charité envers les autres créatures, une paresse à s’infliger les désagréments d’un comportement moral combinée à de grands discours sur la vertu morale, et une foi rigide en la Bible de la prospérité, cette assurance réconfortante que, d'une manière ou d'une autre, le libre jeu du marché finira par tout arranger et que toute cruauté sera effacée par le fonctionnement miraculeux du capitalisme ». (p. 108)
Non contents de se montrer au-dessous de tout sur le chapitre du bien-être animal, les conservateurs tirent de cette attitude un argument supplémentaire pour persévérer dans cette voie : que les revendications d’une meilleure protection des animaux ne viennent pas d’eux serait la preuve qu’il s’agit encore d’une lubie des tenants du politiquement correct. Raison de plus pour dédaigner cette préoccupation de gauchistes ! À cela, Scully rétorque qu’« en réalité, la cause animale n’est jamais devenue politiquement correcte, peut-être parce que, plus que l’allégeance à une idée ou une doctrine, elle exige un acte de volonté conscient et un changement des habitudes personnelles. » (p.107)
En somme, si le conservatisme peut en principe fort bien se conjuguer avec des pratiques personnelles et des décisions politiques respectueuses des animaux, les conservateurs sont loin de s’illustrer en la matière.
Ce diagnostic porté par Matthew Scully au début des années 2000 reste exact un quart de siècle plus tard. Encore plus que dans le reste de la société (où la situation n’est déjà pas brillante), le discours dominant dans les milieux de droite porte à se solidariser des acteurs de l’exploitation animale (chasseurs, éleveurs…) plutôt que des animaux qu’ils tiennent en leur pouvoir.
Il serait toutefois excessif de conclure que Scully a prêché dans le désert. Des lecteurs conservateurs sensibles à la cause animale n’ont pas manqué de lui manifester leur gratitude, heureux de voir leurs préoccupations portées par un homme dont les valeurs et le ton leur conviennent. Il est arrivé aussi que Scully amène des intellectuels de droite à le rejoindre dans son plaidoyer pour les animaux. C’est le cas notamment de l’essayiste Mary Eberstadt, dont les thèmes de prédilection sont restés la famille et la religion, mais qui a évolué sur la question animale à la lecture de Dominion (Footnote: Voici ce qu’Eberstadt écrit dans la préface qu’elle a rédigée pour For Love of Animals, un livre de Charles Camosy paru en 2013 : « … j’ai cessé de manger des mammifères et des oiseaux il y a quelque temps, après des décennies dé végétarisme intermittent […]. En ce qui me concerne, le changement n’a guère été dû à un questionnement philosophique sur le spécisme ; il est venu de choses plus viscérales. En particulier, je ne parvenais pas à contourner une question soulevée de façon frappante par Matthew Scully dans son livre fondateur Dominion : The Power of Man, the Suffering of Animals, and the Call to Mercy : si je ne suis pas prête à tuer ces créatures de mes propres mains (et je ne le suis certainement pas), de quel droit ou au nom de quelle norme morale pourrais bien déléguer à d’autres l’acte brutal de tuer, en particulier à ces “autres” plus pauvres, plus sombres et plus désespérés qui font tourner les abattoirs américains emplis de cris et qui travaillent dans la puanteur des élevages industriels de poulets ? Il m’a fallu quelques années et beaucoup d’autres questions, mais, au bout du compte, Dominion a eu un impact décisif sur ma vie […]. »), et qui désormais évoque cette question dans certains de ses livres et articles.
Il n’est pas indifférent que de telles voix existent. Si elles deviennent plus nombreuses, davantage de conservateurs sensibles au sort des bêtes oseront à l’avenir exprimer ouvertement qu’ils soutiennent des réformes ambitieuses en matière de bien-être animal : ils redouteront moins ce faisant de passer pour des traîtres à leur camp.
4. Comment progresser vers une meilleure protection des animaux ?
Pourquoi la maltraitance animale est-elle si profonde et massive et qu’est-ce qui permettrait de la faire reculer ? Les réflexions de Scully sur ces questions sont pour partie d’ordre général et pour partie plus spécifiquement tournées vers le cas des États-Unis.
4.1. Centralité de la question de l’élevage industriel
À l’époque où Scully rédigeait Dominion, il était fréquent que l’opposition entre welfarisme et abolitionnisme occupe beaucoup de place dans les discussions entre militants animalistes et passe pour une ligne de démarcation décisive. Rien de tel chez Scully, qui ne mentionne même pas ces deux termes.
Il croit et espère qu’un jour les humains cesseront totalement de consommer des produits d’origine animale (Footnote: Cela apparaît notamment dans la réponse apportée à un lecteur qui l’interroge sur ce point. (Chercher la question posée par un lecteur résidant à Sacramento.)). Des passages de son livre indiquent assez clairement qu’il estime que, dès à présent, cette consommation n’est plus moralement justifiable : parce qu’on ne peut plus prétendre qu’elle répond à une nécessité (Footnote: Voir par exemple le passage (p. 129) où Scully cite un extrait du livre The Quest for God (1996) du conservateur britannique Paul Johnson dans lequel ce dernier soutient que Dieu a permis aux humains de manger de la chair parce qu’il fut un temps où ils n’auraient pas pu survivre sans cela, puis ajoute que cette condition a cessé d’être remplie puisque désormais nous disposons d’une abondance d’excellents substituts aux produits animaux.).
Néanmoins, concernant les usages alimentaires des animaux, il concentre nettement ses assauts contre l’élevage industriel, plutôt que contre l’élevage tout court. Il fait une différence entre les acteurs de l’élevage intensif, qui ne mettent aucune limite à la maltraitance des animaux du moment qu’elle leur est profitable, et les petits fermiers indépendants qui ont conservé des modes d’élevage plus anciens. Tout en notant que ces derniers ont eux aussi des pratiques rudes envers les bêtes, Scully leur reconnaît une connaissance des mœurs de leurs animaux, et une certaine prise en compte des besoins qui en découlent.
Dans un passage du chapitre 7, il loue Robert F. Kennedy Jr. pour avoir dénoncé l’élevage industriel comme une torture infligée aux animaux leur vie durant, et pour avoir mené campagne contre les dégâts environnementaux causés par Smithfield. Il rappelle que Robert F. Kennedy Jr. dit n’acheter sa viande qu’auprès de petits fermiers qui traitent bien leurs animaux et note que cela lui semble être un compromis décent. Il ajoute toutefois que ce genre de fermiers est en voie de disparition aux États-Unis, de sorte que la plupart des consommateurs ne vont avoir le choix qu’entre deux options : être « radicalement gentils ou radicalement cruels » (p. 116). Ailleurs, il laisse entendre qu’il serait illusoire de faire miroiter un avenir où tout le monde mangerait de la viande issue d’animaux élevés dans des conditions convenables. « Les élevages géants deviennent inévitables avec l'augmentation de la population humaine et l’intensification de la concurrence économique. » (p.29)
Que peut-on espérer des consommateurs ? Le tableau que dresse Scully par touches successives réparties à divers endroits de son livre n’est guère encourageant, même s’il n’est pas totalement noir. L’auteur se réjouit de la progression du végétarisme chez les jeunes Américains (avec des chiffres probablement surestimés). Il observe que le public se passionne pour les histoires d’animaux évadés des abattoirs et souhaite ardemment que la cavale se termine bien pour eux, ce qui suggère que les gens ont un bon fond. Cependant, au quotidien, ils achètent très volontiers et en quantité les produits de l’élevage industriel, soit en évitant de se poser des questions, soit en affichant une préférence purement verbale pour la viande issue d’élevages plus respectueux des animaux.
Scully est de surcroît bien placé pour savoir avec quelle facilité on fait passer les végétariens pour des excentriques ou des extrémistes. Il a l’expérience de se sentir mal à l’aise quand il est invité à des fêtes et barbecues. Il relate les réactions consternantes – venant d’hommes surtout – à un article dénonçant l’élevage intensif qu’il avait signé dans National Review. On reconnaît dans les propos qu’il rapporte le style de commentaires que suscite dans n’importe quel média une prise de parole d’un végétarien pour les animaux. Après la rituelle concession que oui, l’élevage intensif soulève quelques problèmes, arrive un déferlement de « Laissez-nous manger ce qu’on aime, on ne vous empêche pas de déguster votre tofu ! », et de « Miam ! Une bonne côte de porc ! » tandis que chacun invite à saliver sur son plat carné favori décrit avec force détails. Et Scully d’avoir les mêmes pensées affligées que les autres défenseurs des animaux d’élevage en ces circonstances :
Que défendent vraiment ici tous ces hommes courageux ? Un plaisir. Une saveur. Une sensation dans leur estomac. Et qu'est-ce que cela dit d'eux ? La vie leur a présenté un problème moral, peut-être un petit problème à leurs yeux, mais un problème moral tout de même, et voilà tout ce à quoi ils arrivent à penser : à des poules [cuisinées], à des hamburgers et à des filets de porc farcis de pruneaux et d'abricots secs. C’est juste trop compliqué, trop dérangeant, de changer. J’entends souvent cela, même venant de personnes que j’admire, – la voix de l’appétence qui ne souffre pas la moindre critique, non seulement indifférente aux animaux mais méprisante envers ceux qui s’en soucient. Et franchement, face aux épreuves et à la terreur infligées à nos animaux d’élevage, face aux lagunes remplies d’immondices, « Miam, c’est si bon » n’est pas l’idée que je me fais de la réponse d’un homme. (p. 319-320)
Scully relève aussi que la référence à l’élevage industriel occupe une place de choix dans l’argumentaire des ennemis des animaux.
Cette pratique, désormais banalisée, est invoquée pour s’opposer à n’importe quelle réforme visant à protéger les animaux d’autres sévices. Vous voulez interdire la chasse à courre ? le piégeage d‘animaux sauvages ? l’expérimentation animale ? la corrida ? Mais voyons ! Ce n’est pas pire (ou sert des buts plus nobles) que l’élevage industriel ! Et le fait est que si on entre, comme ils nous y invitent, dans la logique du « pas pire que », alors on doit leur donner raison, car :
L’élevage industriel ne consiste pas seulement à tuer. C’est une négation, un déni total des animaux en tant qu’êtres vivants ayant leurs propres besoins et leur propre nature. Ce n'est pas le pire mal que nous puissions faire, mais c'est le pire mal que nous puissions leur faire à eux. Il nous place face à l’équivalent de la condamnation de l'esclavage humain par Abraham Lincoln : « Si l'esclavage n'est pas mauvais, alors rien n’est mauvais. »
Prenez n’importe laquelle des autres choses que j’ai décrites dans ce livre – les éléphants pris en embuscade au point d’eau, les bébés singes arrachés à leurs mères et mangés vivants, les dauphins piégés et frappés à mort – et le fait est que rien de tout cela n’est pire que ce que nous tolérons dans nos fermes usines. Peut-être partagez-vous mon opinion sur les personnes qui font ces autres choses. Vous pouvez les qualifier de cruelles. Vous pouvez déclarer leur conduite répréhensible. Mais elles ont une réponse toute prête : « Vous mangez de la viande, n’est-ce pas ? » (p. 289)
Il arrive aussi que les défenseurs de l’élevage industriel s’opposent à des réformes dans d’autres domaines parce qu’ils redoutent la « pente glissante » : il ne faut pas mettre le doigt dans l’engrenage d’une meilleure protection des animaux, sans quoi on risque à terme de remettre en cause les pratiques devenues dominantes dans la production de chair, lait et œufs. Scully en donne un premier exemple quand il retrace le débat à la Chambre des communes britannique lors du vote (en 2000) de la loi interdisant l’élevage pour la fourrure au nom du bien-être animal. Un opposant à cette mesure, le député Maclean, expliqua qu’il ne voyait pas en quoi l’élevage de lapins pour la fourrure serait moralement condamnable alors qu’on admet l’élevage de lapins pour la viande, et que les lapins destinés aux deux usages sont encagés de la même façon. Son objectif n’était évidemment pas d’élargir l’interdiction aux animaux élevés pour leur chair.
Scully donne un second exemple qui, lui, concerne les États-Unis. En 1999, fut promulguée une loi interdisant la création, la vente et la détention de crush videos mettant en scène des actes de cruauté envers des animaux : le genre de vidéos où l’on voit une femme à talons hauts écraser lentement un petit animal. Une large majorité des membres du Congrès votèrent en faveur de cette mesure. Scully, qui a assisté aux auditions destinées à éclairer le débat, se souvient qu’une de ces vidéos y fut projetée : c’était insoutenable. Il se trouva néanmoins 42 élus pour batailler contre l’adoption du projet de loi, principalement originaires de l’ouest et de régions rurales. Ils firent valoir le droit constitutionnel à la liberté d’expression, mais avaient clairement en tête la protection du secteur économique de l’élevage qui aurait tant à perdre si la condamnation de la cruauté envers les animaux venait à s’étendre.
Les remarques réunies dans cette section éclairent probablement les raisons pour lesquelles Scully conçoit la lutte contre l’élevage industriel à la fois comme essentielle et comme déjà si difficile à mener que le plaidoyer pour le véganisme, bien que présent, n’apparaît que par touches discrètes dans son livre. Cette forme d’élevage, désormais normalisée, ruine l’existence entière d’un nombre gigantesque d’animaux. Elle a placé très haut la barre des sévices qu’il est socialement et légalement permis d’infliger aux bêtes, au point qu’on peut dire de presque toutes les autres pratiques nocives qu’elles causent moins de torts aux animaux ou qu’elles n’affectent qu’un plus petit nombre d’entre eux. Enfin, une difficulté spécifique tient au fait que cette activité prospère grâce à la participation quotidienne de l’immense majorité des consommateurs, alors que la plupart d’entre eux ne pratiquent pas la chasse de loisir et ne mangent pas de chair de baleine.
4.2. Un paradoxe apparent
Comment se fait-il que la maltraitance des animaux perdure et s’amplifie alors qu’elle ne répond à aucune nécessité vitale ? La situation semble paradoxale. En effet, Scully soutient, on l’a vu, que la condamnation des atrocités commises envers les bêtes n’exige pas de révolutionner nos normes morales. Il rappelle que la plupart des gens souscrivent à la proposition « il est mal de faire souffrir les animaux ». L’auteur ajoute que la disparition des pratiques dénoncées dans son livre n’entraînerait aucun bouleversement profond de nos modes de vie. Si le changement était acté, certains ne se rendraient même pas compte qu’il a eu lieu et les autres approuveraient la disparition des anciennes pratiques.
Cependant, le changement n’a pas lieu. Pourquoi ? Pour Scully, on a affaire à une configuration classique dans le champ politique ou social : des pôles actifs, puissants, bien organisés, défendent les intérêts de divers acteurs de l’exploitation animale tandis qu’en face, il n’y a rien d’équivalent pour les contrer.
Dans un problème politique familier, la cruauté institutionnelle dispose d'un groupe de pression actif et influent, tandis que la bonté n’a pour elle qu’un sentiment aussi répandu qu’inefficace. (p. 389)
Il y a foule pour déplorer la cruauté envers les bêtes au moment où des événements la rendent plus perceptible. Cependant, cette foule est inerte. Elle s’émeut occasionnellement, mais ne constitue pas une force dressée contre la maltraitance animale.
Un auteur décrivant les méthodes de l’élevage industriel ou les excès de la chasse de loisir, ou même les formes les plus dures d’expérimentation animale, écrit avec la conviction que la plupart des lecteurs partageront son inquiétude et son indignation. Appeler à l’action – convaincre les gens que le changement est non seulement nécessaire, mais réellement possible – est plus problématique. En matière de protection des animaux contre la cruauté, il n’y a toujours qu’un pas entre l’appartenance au courant dominant et la marginalité. Condamner le mal est évident, suggérer son abolition est radical. (p. 350-351)
… [les actes de cruauté] s’avèrent presque toujours être le fait d’une petite minorité perverse qui inflige les pires sévices et s’oppose aux réformes les plus élémentaires. « Notre » pire faute est la permissivité, l’inattention, ou, dans le cas de l’élevage industriel, la complicité. Cependant, tandis que la majorité non violente regarde poliment ailleurs, la petite minorité ne s’impose aucune retenue et ne se heurte qu’à très peu de contraintes légales. Ce qui est vrai pour la violence en général, dans n’importe quelle société, l’est aussi pour la cruauté envers les animaux : de l’ordre de quatre-vingt-dix pour cent des problèmes proviennent d’environ cinq pour cent de la population. (p. 352)
Dans le contexte actuel, le précepte « il est mal de faire souffrir les animaux » est inopérant parce qu’il se trouve toujours un groupe de pression apte à faire prévaloir quelque autre raison ou principe : la filière viande vante sa contribution essentielle à la couverture des besoins alimentaires, l’industrie baleinière fait valoir que la chasse est son gagne-pain, les acteurs de l’expérimentation animale arguent de la nécessité de laisser libre cours à des recherches qui favorisent la connaissance ou la santé humaine, etc.
Après avoir posé ce diagnostic, Scully en vient à la question des remèdes. Ses propositions pour améliorer la condition animale sont rassemblées pour la plupart dans le huitième et dernier chapitre de Dominion.
4.3. Les animaux ont besoin d’être protégés par la loi
Pour comprendre quel est, selon Scully, le principal élément manquant pour assurer une protection effective aux animaux, il est utile de se reporter à ce qu’il écrit au chapitre 7 de Dominion concernant la protection des humains.
L’auteur rappelle qu’il a fallu des siècles pour réaliser que les êtres humains ne pouvaient mener vie bonne sans que leur soient garantis des droits fondamentaux tels que le droit de propriété, la liberté d’expression, la liberté d’association, la liberté religieuse, ou la protection contre la torture ou la mise en esclavage. Ces droits, qui nous semblent aujourd’hui relever de l’évidence, sont pourtant encore loin d’être respectés partout dans le monde. Ils constituent « une réponse pratique au plus fondamental des problèmes moraux : la mauvaiseté humaine (human evil) » (p. 313). Grâce à ces droits, des éléments essentiels au bien-être humain cessent d’être négociables : ils ne peuvent plus être négligés pour satisfaire d’autres intérêts ou valeurs.
Il n’existe rien (ou très peu) qui soit du même ordre pour les animaux. Ce qui manque, ce sont des interdits absolus et effectifs de leur porter atteinte de certaines manières. C’est seulement lorsque de tels interdits sont mis en place, et à la hauteur du contenu qu’on leur donne, que le précepte « Il est mal de faire souffrir les animaux » acquiert une réelle consistance.
Conformément aux considérations qui précèdent, Scully place la protection par la loi (le droit positif) au premier rang des moyens d’assurer une amélioration de la condition animale. Au passage, il manifeste une fois encore sa conviction que l’essentiel ne réside pas dans les théories philosophiques élaborées pour justifier ce que nous devons aux bêtes, ni même dans les références spirituelles ou religieuses mobilisées dans le même but (bien qu’elles abondent chez lui). Sur ce plan, il appartient à chacun de chercher la voie qui lui convient.
Tout ce dont les animaux ont besoin, et que nous leur devons sur le plan légal, ce sont des sanctions pénales spécifiques, claires et surtout cohérentes déclarant qu’on ne doit pas [Thou Shalt Not] les soumettre à la cruauté humaine, par simple décence et par obligation de justice. Quant aux questions philosophiques et spirituelles ultimes, chacun peut y réfléchir pour lui-même. (p. 349)
Nous pouvons être en désaccord sur l’énoncé précis des règles morales à appliquer, nous pouvons être en désaccord sur ce qui fonde les règles morales, mais là où aucune norme n’est en vigueur, la plupart des gens admettront qu’il faut en établir, fixer des limites, et pour cela, il faut des lois.
Si Scully met en priorité l’accent sur la nécessité de renforcer la protection légale des animaux, il mentionne aussi dans Dominion les progrès de l’offre d’alternatives végétales parmi les facteurs susceptibles d’amenuiser le nombre d’animaux soumis à l’élevage industriel. Il accueillera plus tard avec enthousiasme les perspectives ouvertes par l’agriculture cellulaire (Footnote: Voir par exemple cet article de 2021 intitulé Hello Cultured Meat, Goodbye to the Cruelty of Industrial Animal Farming.).
À plusieurs reprises dans son livre, Scully manifeste son franc rejet de la thèse selon laquelle il serait inutile, et même nocif, de légiférer, car l’idéal serait de s’en remettre au libre jeu du marché et de permettre aux entreprises de répondre au mieux à la demande des consommateurs. Nous avons sous les yeux les effets du laissez-faire pour les animaux et ces effets sont monstrueux, en particulier pour les milliards d’entre eux destinés à la consommation alimentaire.
De la même façon, sur le plan international, Scully voit le danger de faire du libre-échange un principe qui prévaudrait sur toute autre considération et s’inquiète de ce que l’OMC pousse à aller dans ce sens. Il admet tout à fait que la libre circulation des marchandises a des effets bénéfiques. Néanmoins, il estime qu’elle ne doit pas se faire au détriment des droits humains ou du bien-être animal.
Sachant qu’un pays ne peut pas légiférer sur les conditions de production dans un pays étranger, il serait désastreux de le priver d’un autre moyen qu’il a de peser sur ce qu’elles sont : sa politique d’importation. Il doit pouvoir interdire l’entrée sur son territoire de marchandises fabriquées en piétinant les droits humains ou produites sans respecter les normes de bien-être animal en vigueur à l’intérieur de ses frontières.
De plus, un pays doit pouvoir user de mesures de rétorsion commerciales pour forcer un partenaire étranger à renoncer à certaines pratiques. (Scully soutient par exemple que les États-Unis exerceraient une pression efficace en restreignant l’accès des produits japonais à son marché intérieur tant que le Japon ne met pas fin à la chasse à la baleine.)
Parmi les moyens dont dispose un pays pour influer sur la condition animale hors de ses frontières, Scully cite enfin l’orientation donnée à certaines formes d’aide au développement. Il faudrait mettre fin aux programmes qui facilitent l’accès des chasseurs à la faune sauvage et investir davantage dans des formes d’aide qui profitent aux populations locales tout en protégeant les animaux. L’auteur illustre son propos par des mesures, positives ou négatives, financées par l’USAID.
4.4. Les réformes souhaitables de la législation américaine
Concernant la législation aux États-Unis, Scully avance plusieurs propositions. Si elles étaient adoptées, elles marqueraient des avancées considérables tout en restant dans le cadre de ce qui est jugé acceptable par une fraction importante de la population – du moins si l’on se fie aux bonnes intentions à l’égard des animaux manifestées sur le plan déclaratif.
En matière de chasse, on pourrait commencer par interdire des pratiques qui sont désapprouvées y compris par une partie des chasseurs : la chasse en enclos, le recours aux pièges à mâchoires (déjà interdits dans certains États), la chasse aux tourterelles (également interdite dans certains États), l’utilisation d’appâts, les technologies permettent de localiser à coup sûr les animaux, l’importation d’animaux sauvages vivants destinés aux parcs de chasse, l’importation de trophées… Il faut évidemment revoir le statut juridique du Safari Club International pour qu’il cesse de jouir des avantages fiscaux d’une organisation philanthropique.
À propos d’expérimentation animale, l’urgence est de réformer en profondeur l’Animal Welfare Act, la loi qui est censée protéger les animaux de laboratoire et qui est d’une indigence absolue. En l’état, elle ne s’applique qu’à une poignée d’espèces dont sont exclues celles qui forment l’écrasante majorité des victimes des tests. Même pour les animaux des espèces retenues, la protection apportée est illusoire. Il faudrait par ailleurs sévèrement restreindre les domaines dans lesquels le recours à l’expérimentation animale est permis et, même là où il resterait autorisé, mettre fin aux scandaleux abus qui ont lieu et se montrer très exigeant sur les preuves avancées pour soutenir qu’il est impossible de recourir à des méthodes alternatives.
En matière d’élevage, les États-Unis auraient besoin d’un Humane Farming Act qui fixerait une surface minimale par animal, garantirait l’accès à l’extérieur de tous les animaux, définirait les conditions de vie appropriées pour chaque espèce, etc. Cette loi prévoirait de plus un système rigoureux d’inspection des exploitations afin que ses dispositions soient respectées. En pratique, cette loi ferait que les fermes familiales où les animaux sont convenablement traités deviendraient la norme.
Vingt-trois ans plus tard, les réformes ambitieuses que Scully appelle de ses vœux dans Dominion n’ont pas vu le jour. À l’évidence, le problème est qu’aucun parti politique n’est disposé à les inscrire à son programme, de sorte que l’alternance entre démocrates et républicains à la tête de l’État fédéral n’apporte aucun changement significatif.
L’auteur souligne à raison que tant qu’il n’y a pas de lois protectrices, assorties de moyens de les faire appliquer, les groupes de pression au service des industries animales pèsent beaucoup plus lourd que le sentiment peu opérant du public en défaveur de la maltraitance animale. Il faudrait sans doute ajouter à ce constat le fait que les groupes de pression des acteurs de l’exploitation animale ont depuis longtemps investi dans le lobbying politique, tandis que les groupes de pression animalistes disposent de beaucoup moins de relais auprès des institutions qui décident des politiques publiques. Dans ces conditions, préconiser l’adoption de solides lois de protection animale peut sembler relever du vœu pieux. Comment Scully espère-t-il donc que des avancées seront obtenues ? Pas plus que le reste des militants animalistes, il n’a découvert de recette miracle. Néanmoins, il mentionne deux pistes.
D’une part, il appelle la presse (écrite et audiovisuelle) à s’investir beaucoup plus dans le travail d’enquête et la diffusion d’informations sur la condition animale. Le journalisme d’investigation peut faire beaucoup pour rendre plus présent à l’esprit du public ce qu’endurent les animaux. Or, « le plus grand ennemi de la cruauté est un électorat informé » (p. 389).
D’autre part, Scully songe à une voie qui permet à un électorat informé de peser directement sur les lois en vigueur : les référendums d’initiative populaire, qui sont possibles dans une partie des États fédérés de son pays. Il mentionne avec espoir dans Dominion celui qui a été programmé en Floride pour bannir les stalles de gestation pour les truies, alors que le scrutin n'a pas encore eu lieu au moment où il achève la rédaction de son livre. (La proposition reçut l’approbation d’une majorité d’électeurs floridiens le 5 novembre 2002.) Les quelques progrès enregistrés depuis cette date aux États-Unis (dans certains des États fédérés) l’ont été par la voie référendaire (Footnote: Voir les référendums listés sur cette page.), notamment la proposition 12 approuvée par une majorité d’électeurs californiens en 2018, tandis que la législation fédérale demeurait désespérément pauvre.
Conclusion : au commencement était Lucky
Le chapitre 1 de Dominion est profondément religieux. Le paragraphe qui conclut le volume est profondément religieux. À maints endroits de l’ouvrage, le langage religieux est présent, tant par le nombre de fois où le créateur est mentionné que par la tournure de certaines phrases, ou par les mots mêmes qui sont employés (par exemple, le fait d’utiliser ici et là les termes par lesquels on désigne les péchés pour caractériser nos attitudes fautives envers les animaux). Et pourtant, dans le chapitre 1, qui regorge de références aux Écritures, on voit surgir ce passage dans lequel Scully écrit que le facteur principal qui l’a conduit à faire une grande place aux animaux dans son cœur et dans ses engagements n’a pas été la lecture de la Bible, mais le chien auprès duquel il a vécu durant son enfance et son adolescence – un chien dont il a été particulièrement proche lorsque l’animal était vieillissant.
Plus qu’un quelconque ouvrage de philosophie ou livre sacré, je pense que c'est ce bon vieux Lucky qui m'a appris, au crépuscule de sa vie, à apprécier la beauté des animaux, leur dignité et leur vulnérabilité, ainsi que le lien de mortalité qu’ils partagent avec nous.
Pour moi, étendre cette vision au monde fut un pas moral simple à franchir, car que sont les chiens sinon d’aimables émissaires du règne animal ? Là, dans cette seule créature, il y avait un présent offert à moi et à ma famille, qui apportait tant de vie et de bonheur. Quels présents ils sont tous si notre cœur est orienté dans le bon sens et notre vision sous le bon angle – si nous voyons les animaux tels qu’ils sont indépendamment de nos desseins à leur égard, comme des créatures à part entière […]. (p. 26)
Il est défendable de tenir ce passage pour une anomalie qui ne doit pas masquer que l’engagement de Scully pour les animaux a pour fondement véritable le christianisme, dans l’interprétation qu’il en retient. D’ailleurs, si je n’avais pas tronqué la dernière phrase citée ci-dessus, vous auriez vu qu’elle mentionne elle aussi le créateur (à travers l’affirmation qu’il n’y a aucun animal qui ne soit sous son regard). Si on arbitre le match en comptant le nombre de fois où Lucky est cité par rapport à Dieu, on conclut sans la moindre hésitation que Lucky est battu à plate couture : ce bon vieux Lucky n’est qu’un détail, une anecdote, rien.
Toutefois, l’interprétation inverse est tout à fait plausible : que c’est bien Lucky qui a conduit Scully à prêter attention à la présence des animaux dans le monde, à s’émerveiller de leur existence, à se désoler de leurs malheurs, et à vouloir agir pour leur bien. Pas seulement Lucky. L’auteur rapporte des épisodes de son enfance où la rencontre avec des animaux l’a émotionnellement marqué, comme cette fois où il s’est résolu à achever un oiseau qu’il avait trouvé blessé pour abréger ses souffrances. Tout cela a eu lieu bien avant qu’il se demande comment, avec des mots, inciter des tiers à la bienveillance envers les animaux, et bien avant qu’il soit assez expert en théologie pour connaître les interprétations de la Bible qui ne réduisent pas les bêtes au rôle de ressources pour les humains. De même, Scully a décidé de devenir végétarien en un temps où il y a peu de chances qu’il y ait été encouragé par l’exemple de personnes de son entourage ou par la lecture d’un tract l’invitant à épargner des vies en optant pour ce régime. Qui d’autre que des animaux qu’il a croisés ou fréquentés aurait bien pu éveiller en lui les sentiments et pensées qui l’ont conduit à ce choix ?
D’ailleurs, des années plus tard, après s’être amplement documenté sur la question animale, Scully exprime dans le texte même de Dominion sa conviction qu’au fondement de notre connexion avec les animaux il y a quelque chose (« un peu d’amour ») de plus profond et plus basique que des idées puisées dans une culture livresque, même s’il ne lui arrive qu’une seule fois d’inclure le livre sacré parmi les facteurs d’importance secondaire.
D’autres indices portent à penser que Lucky a réellement beaucoup compté pour Matthew Scully et a beaucoup contribué à forger son attitude envers les animaux. Une même dédicace figure en tête des deux ouvrages qu’il a consacrés à la cause animale, Dominion (2002) et Fear Factories (2023) : « À la mémoire de mon ami Lucky ». En outre, Scully a longuement parlé de sa vie avec Lucky et de ce que cette relation lui avait appris dans un article (en libre accès) paru en mars 2020 sous le titre « Lessons from a Dog ».
Il n’y a rien de rebutant, au contraire, dans l’hypothèse que des animaux soient directement, en personne, le moteur qui nous pousse à nous soucier d’eux, parce que nous (certains d’entre nous du moins) avons la faculté de les voir, d’éprouver de l’intérêt ou de l’affection pour eux, de comprendre qu’ils ont leurs propres buts, joies et peines. Il n’est pas aberrant de supposer que la relation particulière que nous avons nouée avec quelques-uns parmi eux (ou l’émotion ressentie en découvrant en images ce que vivent certains d’entre eux) puisse être le chemin qui nous conduit à élargir notre perspective à un ensemble d’êtres plus vaste. Reconnaître cela évite de mettre les premiers concernés hors-jeu – d’en faire des impuissants à avoir la moindre influence sur leur propre sort, lequel dépendrait tout entier de la capacité de nos incomparables cerveaux à générer des thèses qui « démontrent » qu’il est injustifié de les négliger.
Il est vrai que la plupart des auteurs qui produisent un discours construit destiné à persuader leurs congénères d’épargner ou de secourir les bêtes s’emploient à créer chez leurs lecteurs un sentiment de devoir, d’obligation, envers les animaux. C’est alors que ces auteurs font intervenir des « autorités » qui « ordonnent » de prendre soin des êtres sentients non humains, accordant souvent à celles-ci une très grande place dans leur exposé. Les autorités en question sont des entités abstraites ou invisibles. Elles ne disposent en tant que telles d’aucun bras armé nous forçant à obéir aux commandements qu’elles énoncent. Mais grâce à elles, c’est comme si tout à coup ces auteurs (et les animaux) n’étaient plus seuls à vouloir un meilleur sort pour les bêtes : ils ont l’appui de quelque chose de plus grand, de plus noble et de plus incontestable, que cette chose soit « la rationalité », « l’éthique » ou, comme chez Scully, « Dieu ».
Il ne m’incombe fort heureusement pas d’évaluer ici la nature et la validité des entités ainsi invoquées. Sans sous-estimer le travail d’orfèvre accompli par les chercheurs les plus experts dans l’examen de ces notions, et sans oublier qu’il arrive à chacun de nous d’avoir recours aux autorités abstraites ou invisibles pour renforcer nos plaidoyers pour les animaux, il est permis de se réjouir que Scully ait désigné Lucky comme le guide qui l’a conduit à vouloir le bien des créatures animales. Et il est permis de juger cette désignation à la fois méritée et vraisemblable.
Dans un billet de blog paru en décembre 2006, Wesley J. Smith, philosophe fort peu ami du mouvement des droits des animaux, adresse à Dominion une critique que Scully a repérée comme un classique des reproches adressés aux animalistes : ce livre est, selon Smith, « indûment émotionnel ». Le fait est que Scully est sentimental, mais il se pourrait que ce soit là sa force. Bien qu’il mentionne souvent le créateur, il n’a pas produit un docte traité de théologie animale (et n’a jamais songé à prodiguer des leçons inédites de rationalité ou à forger une nouvelle théorie éthique sur le mode profane). Il se sert de ses émotions – de l’écho qu’ont chez lui les émotions animales – et raconte les choses de façon à les communiquer.
Même si l’on est sans dieu, et à moins d’appartenir à l’espèce (nombreuse) qui se mure dans la dénonciation de la sensiblerie, on est porté en le lisant à s’émouvoir de la terreur des éléphanteaux confrontés aux chasseurs, à souffrir avec la baleine harponnée, et à se sentir accablé par le désespoir infini de la truie NPD 50-421. Lorsque les animaux sont ainsi projetés au premier plan de notre conscience, nous n'avons pas besoin de la litanie de raisons fournie par les autorités abstraites ou invisibles pour vouloir que ces atrocités évitables leur soient épargnées. L’explication la plus lumineuse nous semble alors tout entière contenue dans cette formule forgée dans le milieu militant végane : « Pourquoi ? Parce qu’eux. »
© Estiva Reus
Billet publié le 15-07-2025 sur le blog du site estivareus.com
Crédit illustration : © Frédéric Dupont
Notes
Notes :